Les très belles photos de Lynn Davis sur les déserts glacés inspirent la méditation et le respect. Une très belle oeuvre, pleine de sérénité.
Voir les baleines à Puerto Pirámides
La passion des cartes poussent parfois à regarder de très près ce qui se passe sur Terre. Les dessins aléatoires visibles depuis le ciel intriguent, interrogent, poussent à chercher ce qui s’est passé depuis des millions d’années, en particulier en ce qui concerne les côtes, les étranges arabesques et volutes façonnées par un conflit permanent entre les forces telluriques de la lithosphère et les courants marins.
La péninsule Valdès, sur la côte argentine, fait partie de ces accidents de la nature. Située dans ce qui est communément nommé la Mer Argentine, elle n’est reliée à la terre que par un isthme étroit, le Carlos Ameghino. La particularité formelle de ce lieu tient aux échancrures qui déchirent la côte au nord et sud, donnant à voir une langue de terre en forme d’oeuf de seiche. Sa situatation géographique la protège des fortes précipitions des Andes, ce qui lui confère un aspect désertique, mais bénéficie d’un climat marin sur ses côtes, attirant ainsi une faune variée et d’autant plus présente que les lieux sont protégés. Deux salines gigantesques, de presque huit kilomètres de diamètre trouent la surface de la péninsule tout en se trouvant bien au dessous du niveau de la mer. Sur les côtes, on peut apprécier des paysages de falaises crayeuses aussi bien que de longues plages de sable situées plein est.
Dans le golfo Nuevo, au sud, une petite ville, Puerto Pirámides, est un haut lieu du naturalisme argentin puisque c’est ici que viennent du monde entier les amoureux des baleines franches.
 Photo © Ande Wanderer
Photo © Ande Wanderer
Fabienne et moi avons décidé de vous emmener dans un tour du monde virtuel. Vous pouvez suivre les étapes de ce voyage sur Google Maps (c’est magique !)…
Un empire de poussière
Pas une seule fois je n’ai écrit le mot opium… Pas une seule fois. Pourtant, j’en ai eu plusieurs fois l’occasion et je pourrais encore le faire… si toutefois je ne venais de le faire. J’aime énormément ce mot qui m’entraîne immédiatement sur les routes de l’Inde, dans les fumeries crasseuses de Lahore ou dans les ruelles d’un Shangai antédiluvien. L’opium rêvé ou maudit, objet de convoitise ou de mépris, ce mot me fait toujours rêver car il retient en lui l’incroyable possibilité de générer de l’illusion, métaphorique ou non.
Entre le rêve et la réalité, entre l’âge adulte et l’adolescence, voire l’enfance, il n’y a qu’un pas que l’on peut franchir avec plus ou moins facilité ou de sincérité. Entre ce que je vis et ce que je ne vis pas, entre ce qui est et ce qui pourrait être, entre ce qui aurait pu ou aurait dû être, les frontières s’effacent, ma vision se brouille et lorsque je regarde autour de moi, j’éprouve parfois comme un léger vertige qui me fait me demander si je n’ai pas rêvé, ou alors si définitivement, je ne suis pas devenu un peu dingue. Lorsque cette histoire verra arriver son terme, nous en saurons certainement un peu plus.
Dingue, lui, il l’est devenu. Il portait un prénom de cavalier valeureux et vivait à l’ombre des autres, isolé, caché du reste du monde bruyant, dans une relative tranquillité pétrie de silences et d’ombres, et peut-être aussi d’illusions sauvages, de silhouettes qui se reflètent sur les murs, de grains de sable restés collés sous ses semelles lorsque du désert il s’extirpait. Son quotidien n’était pas autre chose que petites contrariétés, morne combat contre la morosité, absence totale de sentiments, aucune d’affection à son égard, personne pour l’aimer, la solitude froide et terne, le désir sans direction, un monde uniquement fait de la capacité qu’il avait à en sortir par le pouvoir de son imagination.
Il lisait beaucoup, les livres lui permettant de ne pas penser à ce qu’il était. C’est à dire pas grand chose. Il se sentait seul, mais ne le savait pas encore, parce qu’on ne sait ces choses là que lorsqu’on en sort, et qu’on y retourne. C’est à ce moment là que la solitude prend une dimension absurde. Il avait froid aussi. Son corps raidi. Son esprit devenu rigide. Son visage durci.
Le côté lumineux de son être, c’était la face découverte, son paraître. Il écrivait et des gens lisait ce qu’il écrivait. C’était sa seule ouverture sur le monde, sa seule joie de vivre et son unique objet de désir.
Seul, il l’était, et seul il vivait. Un soir, en rentrant du travail, il trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe suspecte. Ce n’était ni une facture, ni un tract publicitaire, mais une lettre qui lui était destinée, son nom et son adresse inscrits dessus avec une écriture ronde et douce ne laissait pas de place au doute. Pas de nom derrière. Juste un parfum boisé très discret qui en émanait. Il se passa la langue sur les lèvres en la décachetant fiévreusement, toujours sur le seuil devant le bataillon de boîtes aux lettres alignées.
La suite, un autre jour, une autre fois.

Note de bas de page: deux données sont à saisir dans ce texte ; l’imaginaire et la faculté de création. Morceau de vie réelle, texte fictif, autofiction ? Savoir si cette histoire est vraie ou non n’est pas la question car finalement, cela n’intéresse que les personnes qui me connaissent, ce qui constitue somme toute un bien maigre bataillon. Cela nous intéresse t-il réellement ? La vérité n’est qu’une donnée relative à l’existence particulière. Finalement, c’est bien peu de choses, et puis on verra ce que donne la suite.
Where We Live, Berman Collection
Where We Live: Photographs of America from the Berman Collection est une exposition (ses portes ont fermé en février dernier) regroupant des photos collectées par les époux Berman. On y retrouve des artistes comme Stephen Shore, Robert Adams ou Joel Sternfeld, tous témoins d’une Amérique en perdition, chasseurs d’images à caractère ethnographique de lieux abandonnés. Un panorama assez large de ce courant réaliste destiné à faire comprendre au reste du monde, où vivent les Américains.
Hasard des choses, en revenant sur d’anciens billets collectés, je me suis rendu compte que le très beau Rouge Blog avait publié un article sur Joel Sternfeld le 17 mai dernier.
Léonie d'Aunet
En 1839, Léonie a 19 ans. Il est à peu près certain qu’elle est la première Européenne à aborder la Laponie. Quelques années plus tard, elle affrontera des péripéties autrement périlleuses pour une femme. Elle sera surprise en flagrant délit d’adultère avec Victor Hugo. Vilipendée dans la presse, elle sera même incarcérée à Saint-Lazare, avant d’être bouclée dans un couvent pour trois mois. La mésaventure du pair de France mis fort en émoi son collègue Lamartine : “L’aventure de mon pauvre ami Hugo me désole… Ce qui doit être navrant pour lui, c’est de sentir cette pauvre femme en prison, pendant qu’il est libre.” Pas un mot sur les affres de Léonie qui n’est pas femme à baisser les bras en pareille adversité. Tout le monde lui tourne le dos. Elle est sans le sou. Qu’à cela ne tienne, elle gagnera sa vie en publiant en 1854, Voyage d’une femme au Spitzberg. Le succès est au rendez-vous. Elle est devenue une femme libre qui va continuer de publier avec un talent certain. Les méchantes langues diront, à tort, que c’est Victor Hugo qui tient la plume… Il faut dire que Léonie, de grande beauté, audacieuse à l’extrëme, pas gênée de cocufier son mari, portraitiste à la cour de Louis-Philippe, avec une gloire nationale, prêtait son admirable flanc à la critique bigote de ces temps-là. Et si ces beaux hypocrites avaient pu lire ce qui lui écrivit l’ardent Victor, ils auraient avalé de travers leur digne salive : “Vois-tu dans les moments où je pénètre dans toi, où nous sommes moralement et physiquement, tellement mêlés… nous ne sommes plus en réalité… qu’un seul corps, qu’une seule âme, dans ces moments-là, je voudrais mourir.”
Françoise Benassis, in Le goût du désert, Petit Mercure
Perles du désert
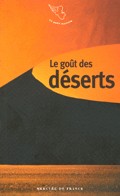
Riche idée de la part des éditions Mercure de France de publier dans la collection Petit Mercure ces recueils de textes thématiques.
Errant dans le rayon littérature de voyage, coincé entre un livre de Nicolas Bouvier et un autre d’Ella Maillart, j’ai découvert ce petit recueil, le goût des déserts. Persuadé que j’y trouverai des ambiances dont je suis friand, je me suis trouvé face à des auteurs que je ne connaissais pas, des personnages dont je ne soupçonnais pas l’existence et des destins hors du commun.
J’y ai découvert Ibn Baṭūṭa, amateur de melons, mais aussi le Vicomte Charles de Foucauld, un noble périgourdin qui finira sa vie assassiné dans un ermitage du Sahara, et le très énigmatique Michel Vieuchange qui déguisé en femme visitera la ville interdite de Smara.
On y découvre aussi des trésors de poésie comme ce texte rapporté par Anne-Marie Tolba dans Villes de sable, les cités bibliothèques du désert mauritanien.
Mon pays est une perle discrète
Telles des traces dans le sable
Mon pays est une perle discrète
Tels des murmures des vagues
Sous un bruissement vespéral
Mon pays est un palimpseste
Où s’usent mes yeux insomniaques
Pour traquer la mémoireOusmane Moussa Diagana, Notules de rêve pour une symphonie amoureuse.
Un peu hors propos, mais d’une beauté rare, ces mots de Lyautey à propos d’Isabelle Eberhardt :
“… Elle était ce qui m’attirait le plus au monde “une réfractaire” et trouver quelqu’un qui est vraiment soi, qui est hors de tout préjugé, hors de toute inféodation, de tout cliché, et qui passe à travers la vie aussi libérée qu’un oiseau dans l’espace, quel régal !”
L’horizon s’ouvre de multiples possibles avec ce petit livre, comme avec ce superbe poème d’Amr Ibn Kalthoum :
Elle te laisse voir quand seul à seul tu l’approches…
deux bras pareils au col d’une chamelonne toute blanche
jouvencelle racée qui n’a jamais conçu
un sein plus moëlleux que bure d’ivoire préservée des mains des toucheurs
et ces reins tendres et longs et vivaces et ces rondeurs que leur voisinage alourdit
et ces hauts de cuisse à resserrer la porte et cette taille qui affole ma folie
et ces deux piliers d’ivoire et de marbre sonnant du cliquetis des bijoux […]
Pour finir, ces quelques mots de Dino Buzzati, celui des Tartares :
Selon moi, ce qui fait surtout impression dans le désert, c’est le sentiment de l’attente. On a la sensation que quelque chose doit arriver, d’un moment à l’autre. Vraiment. Là, jaillit des choses que l’on voit.
Depuis la mer
Couleur vent du désert
Il fait bon ce matin. En me levant, derrière les rideaux, je croyais qu’il pleuvait; ce n’était certainement que mon imagination. J’ai beaucoup d’imagination. J’en ai tellement que sous des apparences banales, je suis capable de m’inventer une vie en rêve, et tandis que j’ai – a priori – passé un week-end tout ce qu’il y a de plus normal, simple, banal, il s’est en réalité passé plein de choses. J’ai passé mon temps à rêver, arborant un léger sourire empreint de bonheur. Tout simplement transporté, transcendé, absolument ensorcelé. Aujourd’hui, à peine reposé et des douleurs un peu partout, je me réveille dans un état second, comme si j’avais passé mon temps à faire l’amour… Plus que jamais je me répète des mots qui semblent être taillés pour moi.
 Photo © Elisham
Photo © Elisham
Je me souviens d’un texte que j’avais écrit il y a quelques temps dans lequel je faisais part de mes déceptions quant à ce que mon pays devenait. Si je fais le bilan aujourd’hui, je me rends compte qu’en fait, je m’en contrefous. Je m’en contrefous parce que je n’y suis plus. La France est devenu un pays merdeux, quelque chose qui n’a plus rien à voir avec ce qu’il était dans mon enfance, pas plus qu’il ne ressemble à l’image qu’il pourrait avoir. Je repensais à cela ce matin dans le train. Et puis je me suis souvenu d’un texte que j’avais écrit dans mon adolescence dans lequel je disais que je savais d’emblée comment je mourrais, ou plutôt comment j’aimerais mourir. Parce qu’en fait, je m’imagine très bien ne pas mourir ici, je me vois dans quelques années traînant mes guêtres dans les rues sales de Calcutta ou dans un bordel de Singapour, dans les faubourgs désertiques de Windhoek ou sur le Mont Sinaï et à la relecture de Rashômon, je me dis que je n’ai jamais envisagé le monde autrement que sous ses aspects les plus inabordables. Aussi, la France ne signifie t-elle plus rien à mes yeux. Mon pays de naissance ? Oui et alors ? Je n’ai même plus de carte d’identité… Ces contours-là s’effacent et je ne m’en porte pas plus mal. Citoyen du monde ? Je m’en fous… C’est le genre de mots bons pour les people en mal de sensations. Qu’importe si je meurs ici ou ailleurs, qu’importe où seront dispersées mes cendres. Je finirai peut-être vieillard rachitique et barbu, nu comme un sādhu Nanga à la recherche du Nirvana, les yeux ravagés par la déesse Ganja, l’esprit aussi rationnel qu’un bol de compote…
نعيم
J’ai enfilé mon pantalon couleur vent du désert en ortie de Chine et un pull en lin marron, presque prêt à courir le monde. Sur ma figure se dessine la félicité, des traits comme dessinés par les récits qui donnent un beau visage.
Aujourd’hui est un nouveau jour, et tous ceux qui suivront le seront également, peu importe ce qui arrive. Mektoub…
Lieux déserts (Doug Hall et quelques autres)
Dans les photos très américaines de Stephen Shore, dans les ténèbres contrastées de Uwe Niggemeier ou dans les innombrables clichés des époux Becher, il se passe quelque chose, ou plutôt ce qui se passe est de l’ordre du rien. On est immédiatement assailli par quelque chose qui devrait passer inaperçu et qui pourtant, comme le silence dans certaines compositions musicales d'Olivier Messiaen est tellement prégnant que ça en devient assourdissant.
Je viens de découvrir les photos de Doug Hall (grâce à MoonRiver), ses paysages routiers, le GDR project et ses non-places. Ce dernier mot résume bien l’histoire de ces photos; ce sont des non lieux, des lieux qui n’existent pas car ils leur manquent quelque chose de fondamental… Une histoire. Dénué de toute présence, ils perdent leur sens et deviennent criants de néant. En fait, ce sont plutôt des photos qui ne racontent pas d’histoires et je trouve toujours aussi surprenant de voir que des artistes poussent leur démarche jusqu’à vider leur oeuvre de signifiant.
C’est l’occasion rêvée de soumettre ce lien que m’a transmis Fabienne (c’est génial de bloguer dans ces conditions, on lance des sujets et des gens réceptifs apportent leur pierre à l’édifice). German Industrial Buildings 1910-1925, une série de photographies collectées par Andy Bleck et qui donne une idée du panorama d’inventivité de ces architectes de l’ère industrielle. Le site contient beaucoup d’autres choses qui n’ont pas grand chose à voir entre elles (et une mise en page digne des premières années du web) mais ça vaut le coup d’oeil.
De Fabienne, il faut lire également le billet qu’elle a écrit sur les Flugabwehrkanone (FLAK) Türme.
Merci également à Helge Fahrnberger de m’avoir aiguillé vers le blog de Haiko Hebig et sa catégorie dédiée à l’héritage industriel par la photographie.
Pulse
Loin d’être calme, je vis chaque moment à toute vitesse, la tête en ébullition… Je n’arrive pas à me concentrer, je carbure au café quinze heures par jour, je commence à m’organiser dans tous les sens, je classe mes affaires, je repère où chaque chose se trouve et je me construis des espaces de rangement strictement virtuels.
En fait, je lis beaucoup de choses, à droite et à gauche, je fais ce qu’il ne faut pas faire, je compare mon écriture à ce qu’ont fait les autres avant moi. Je suis seul dans ce que je fais, je n’ai personne pour me seconder, pas de secrétaire, pas de nègre, je suis tout seul avec mon clavier, mes carnets et mes stylos… Je me rends compte au fur et à mesure que je trouve moi-même les réponses à mes questions sur le fait d’écrire en lisant et relisant ce que j’ai fait dans chacun de mes univers. J’y vois des imbrications, un immense jeu de lego qui se met en place. Et j’adore ça, je suis incroyablement excité (je sais, c’est un peu tout le temps) et je commence à avoir de l’espoir. J’entrevois clairement la possibilité d’écrire plus, mieux, de manière quasiment militaire, et je le fais.
[audio:http://theswedishparrot.com/ftp/02%20-%20Before%20You%20Leave.mp3]
Tu sens les pulsations ? Tu sens comme ça bouge ? Hmmm… Je ne compte plus les fois où je me suis lamenté sur ma paresse et mon manque de volonté, mais tout ça semble être du passé, depuis quelques temps déjà. Je me sens comme un adolescent au purgatoire… Mêmes émois… Aujourd’hui, il est temps de se mettre en route, à l’ancienne, comme au temps où l’on partait sur les routes désertiques avec une grande bagnole avec une seule banquette à l’avant… Un parfum de désert, une traversée des grands espaces que je ne pensais plus possible…
C’est certain qu’Amiens n’est pas le désert, quoique c’est une ville en plein milieu des champs. J’aime me lancer sur cette autoroute A16, alors que le soir est tombé, que le brouillard fin enveloppe la campagne. La vitesse est grisante, il n’y a pas grand monde; je colle mes mains sur le volant, je m’enfonce dans mon siège et j’écrase le champignon pour faire des accélérations spectaculaires qui ne font rire que moi. Le moment de folie passé, je roule tranquillement en regardant l’horizon, en m’imaginant au volant d’une Chevrolet Impala sillonnant le routes de l’Iowa, mais bien vite, je vois des champs de betteraves à perte de vue et je suis au volant d’une 206 qui sent encore l’usine.
Et c’est soudain; c’est le drame. J’ai dû pêcher dans une autre vie, faire beaucoup de mal à des gens très bien, tuer des animaux. Bref, mauvais karma.
Je n’ai même pas parlé des livres que j’ai lu ces derniers temps, ce documentaire bouleversant de John Hersey sur Hiroshima, ce livre divertissant et parfois rude d’Augusten Burroughs, Courir avec des ciseaux, et tous ceux que j’ai entâmé ou entassé sur la tablette qui me sert de table de chevet. J’avais envie de passer à autre chose. Tout à coup, Kerouac, Bukowski, les auteurs japonais, John Fante, mes livres d’architecture, Henry Miller (c’est très californien tout ça), tous ceux qui m’accompagnent d’ordinaire m’ont paru dramatique, trop peu en phase avec la légèreté dont j’avais besoin ces derniers temps. Alors j’ai fait quelque chose que je ne croyais plus possible depuis bien longtemps; lire une oeuvre du XVIIè siècle d’un ecclésiastique britannique. Présentées comme ça, les choses manquent de piquant, c’est certain. J’avais essayé de me plonger dans une matinée d’amour pur de Yukio Mishima (ce nom résonne avec une certaine poésie à mes oreilles, plus que son vrai nom, Kimitake Hiraoka), mais les nouvelles m’ennuient pour le moment. C’est donc avec une certaine joie que je me suis permis de reprendre une lecture qui devait dater d’au moins sept ou huit ans : The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman de Laurence Sterne, volume 1. C’est un texte étonnant, mais j’en ai encore lu trop peu pour pouvoir disserter dessus. La moitié du livre est consacré aux notes de Guy Jouvet, traducteur génialissime qui a su respecter les caprices typographiques de l’auteur. J’aime ces livres savants qui digressent à l’infini et finissent par nous emporter dans un labyrinthe sans fin de connaissances, un peu à la manière des écrits conjoints de Gilles Deleuze et Felix Guattari. Par exemple, j’ai appris hier soir qu’il existait, selon Ambroise Paré, trois niveaux corporels des esprits, mais évidemment, l’intérêt universel de la chose sur ce blog reste somme toute assez limité. Cette lecture est incroyable, impertinente, drôle, terriblement érudite, annotée de citations de Montaigne, La Bruyère et dirigée par les opinions mêmes du traducteur / commentateur.
Il faudrait aussi se replonger dans un livre que j’ai dévoré autrefois pendant mes études, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art : Le problème de l’évolution du style dans l’art moderne de Heinrich Wölfflin. Alors oui, ça parait pédant de placer ça dans une conversation entre le fromage et le dessert, ou alors (et attention, c’est du vécu) au square en rencontrant un couple autrefois ami, poussette et chien en laisse à la clef (Elle dit: je suis désolée, je ne vous invite pas à manger en ce moment, on est plein dans les cartons. Ce que à quoi j’ai répondu intérieurement: “Merci de tout coeur !” Elle reprend: “Mais on peut toujours aller se faire une balade au parc ?” et moi de penser “C’est ça ouais, compte là-dessus, plutôt crever d’une chaude-pisse”), mais au bout du compte, ce livre est très facile à lire et apprend les différences fondamentales entre le style classique et le baroque, dans la courte évolution qui a fait basculer l’un dans l’autre. Non ? Toujours pas convaincu ? Alors on y comprend mieux comment Titien (Bon dieu, il s’appelle Tiziano Vecceli non ? On ne peut pas lui foutre la paix en l’appelant par son vrai nom ?) a révolutionné l’art en son temps. Je n’essaie pas de vous convaincre, je parle en l’air, c’est tout. Et puis lisez aussi Elie Faure et Ernst Gombrich, ça ne peut que faire du bien…
Euh… J’ai parlé du livre de Régis Debray (pauvre homme affublé d’un prénom aussi ridicule, que Dieu pardonne ses parents) Vie et mort de l’¢image. Une histoire du regard en Occident ? Non alors j’en touche deux mots. Ce livre est en fait sa thèse de doctorat, dirigée par François Dagognet, celui-là même qui a fait sa carrière sur les détritus et les sécrétions corporelles (comprenne qui pourra). Et… c’est tout. On ne badine pas avec les grandes oeuvres – avec l’amour non plus.
J’aurais aimé… être… architecte. J’aurais pu si j’avais travaillé.
J’aurais aimé… être… journaliste. Je n’ai jamais essayé.
Et si finalement je devenais écrivain? (dis-je en pouffant).
Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui tourmentent les hommes, mais les opinions qu’ils forment sur les choses.
Epictète, Encheiridion
J’ai une mémoire prodigieuse pour certaines choses, c’est déjà ça non ? Comme chacune des notes de la Marche Funèbre pour la Reine Mary, d’Henry Purcell… – je suis incapable de me souvenir de ce que j’ai fait hier, mais la partition, ça oui, c’est comme si elle était imprimée sur ma rétine – Montez le son, et je vous demande un peu de recueillement pour cette pauvre Mary qui repose par six pieds sous la terre d’Albion – on parle bien de la Reine d’Angleterre, pas du RMS, le paquebot, on est d’accord ?
[audio:http://theswedishparrot.com/ftp/Purcell.mp3]
Comme pour faire contraste avec le superbe portrait de Mary, je pense tout à coup à la grossièreté, dans ce qu’elle a de plus global. A ces mots que je prononce parfois au grand désespoir des gens que je côtoie, à ces textes que je me refuse de censurer parce qu’ils sont ce qu’ils doivent être au moment où je les écris, à toutes ces choses que la morale réprouve. Il me semble qu’on peut tout à fait se gratter les couilles en public, le tout étant de le faire avec élégance. La grossièreté ne trouve de sens que si elle est accompagné de son corrélaire, l’élégance. En disant cela, je pense à la dernière publicité Chanel, pour un rouge à lèvre. On y voit une blonde qui est à mon sens censée représenter le désir, la chair, l’envie, mais le problème c’est que cette poupée donne l’effet totalement opposé. Elle est d’un vulgaire affligeant, on croirait voir un pute fraichement débarquée d’Ukraine, tout ce qu’il y a de plus vulgaire et de repoussant chez la pétasse de luxe. Alors oui, je préfère me gratter les couilles en public avec mon charme habituel plutôt que de subir les charmes éventés d’une catin du port de Hambourg essayant de provoquer en moi des émois sexuels en trémoussant son cul enturbanné avec des lèvres qui me rappellent une danseuse de peep-show dans une rue commerçante de Copenhague (les voyages forment la jeunesse parait-il). Où se trouve la grossièreté ? Dans les mots de Bukowski ou dans les images surfaites d’une publicité pour un rouge à lèvres ? Ou encore dans les mots de cette épitaphe qui ornera ma tombe ?…
Je vous emmerde… Et vous me le rendez bien.
Ceci ne s’adresse pas forcément qu’aux lecteurs du Parisien (bon dieu que ce journal est minable, l’expression même de la vulgarité – encore – d’un certain lectorat)… Je suis de retour, c’est indiscutable (pas de fausse modestie), avec mes stylos Pilot Tech-Point V7, mon envie de crustacés, mes mains et mes doigts dans lesquels on peut voir, selon la lumière, soit la main câleuse du scribe ou la main délicate de l’intellectuel – merde, ce ne sont que des mains après tout – et puis mon irrésistible envie d’être tout pour quelqu’un. Dans ma réclusion, je souffre de la solitude de celui qui désormais ne va faire qu’attendre. Et Dieu sait que je peux être patient pour ce genre de chose, même si ça me ronge les chairs.
[audio:http://theswedishparrot.com/ftp/Bee%20Gees%20-%20Saturday%20Night%20Fever%20-%20Disco%20Inferno.mp3]
Je vais ressortir mes pinceaux, mes carnets et je vais me remettre à peindre avec cette technique si particulière qui consiste à peindre avec du thé. Avec ce soleil, quelques idées en tête, je rêve de navires et de marées lointaines…
Repartir vers le large…













