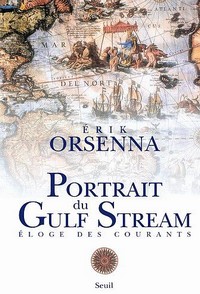
La première fois que j’ai entendu parler d’Erik Orsenna, c’était lorsqu’il était conseiller culturel de François Mtiterrand, dans les années 80. Les personnages comme lui, proches des grands de ce monde, dans les quasi-secrets d’Etat, sont des gens fascinants de par leur proximité des plus hautes affaires de l’Etat. Il fait partie de ces gens, tels que Jacques Attali ou Régis Debray[1] pour qui j’éprouve à la fois un vif intérêt mais aussi une certaine méfiance, car ce sont des gens capables de tout et surtout du meilleur. Je connaissais Orsenna écrivain, sans pour autant avoir lu aucun de ses livres… Il faisait partie de ces gens qu’on voyait sur les plateaux de télévision, auprès de Bernard Pivot ou de Bernard Rapp et qui parlait avec une telle aisance qu’on ne pouvait faire autrement que de laisser son oreille vagabonder au rythme de ses paroles, la mâchoire légèrement pendante. Aussi, lorsque j’ai appris qu’il avait écrit un livre sur le Gulf-Stream[2], je me suis encore plus méfié. L’incursion d’un romancier dans un domaine aussi confidentiel et surtout aussi peu vendeur que la mer ne pouvait que me laisser encore plus méfiant. Quelques années auparavant, mais pas beaucoup, j’étais tombé en pâmoison devant l’excellent Besoin de mer
de Hervé Hamon. Aussi, lorsque j’ai lu la quatrième de couv’ du livre d’Orsenna, je me suis dit que c’était là un livre pour moi. Dans l’ordre logique des choses, j’ai appris qu’il était résident de la petite île majestueuse de Bréhat, et l’été dernier, je le croisais par hasard à la librairie du Renard à Paimpol, en polo bleu marine et bermuda… De quoi désacraliser un homme qui depuis peu est académicien.
Portrait du Gulf Stream : Eloge des courants, Seuil 2005
Erik Orsenna est écrivain de marine et conseiller d’Etat. Il préside le Centre de la mer (La Corderie Royale, Rochefort).

Photo originale en version haute définition visible sur le site de l’Université du Texas
De retour à Paimpol cet été, je me suis dit qu’il serait logique que j’achète ce livre là où j’avais vu l’homme. C’est un acte significatif pour moi, comme lorsque je me suis acheté Mon frère Yves
de Pierre Loti à Paimpol, tout près de la maison dans laquelle il vivait lorsqu’il a également écrit les fameux Pêcheurs d’Islande
. Le gardant sous le coude, j’avais également décidé de l’endroit et du moment où je me plongerai dans cette lecture. Pour moi, il n’était pas question de le lire ailleurs que dans le train qui allait me ramener à Paris. Je me suis donc lancé une fois installé dans le train, et je m’émerveillai à chaque page de tant d’érudition et de simplicité. Parler des courants marins est une gageure, le sujet n’est pas forcément très démocratique, mais lorsqu’on est amoureux de la mer, on plonge facilement dedans. Je me souviens de ce passage, situé au raz de Sein où Orsenna se définit lui-même comme un collectionneur de courants marins[3]. Quoi qu’il en soit, ce livre est l’expression d’un amour profond pour quelque chose d’impossiblement appréhensible, un courant qui parcourt la mer, influe sur la navigation et surtout décide en partie du climat de l’Europe et réchauffe (de manière relative) les côtes de l’Atlantique.
Parmi les anecdotes et les légendes relevées autour des courants, en voici quelques unes qui ont particulièrement retenu mon attention.
Depuis 1753, Benjamin Franklin est… le maître des Postes de sa ville (…) Ses employés postiers ne savent plus répondre à la colère de leur clientèle. Pourquoi les bateaux qui transportent le courrier d’Angleterre en Amérique sont-ils tellement plus lents que les navires marchands américains ? Pourquoi faut-il les attendre deux ou trois semaines de plus ?
C’est ainsi qu’on apprend que Benjamin Franklin fut un de ceux qui s’intéressa de près à notre cher courant marin et qui mettra en évidence que ces retards sont dus à l’influence du courant, qui en l’occurrence est un courant porteur.
Orsenne nous parle à un moment d’un certain Pape qui se nomme de fait Henry Stommel, un universitaire spécialiste de l’océanographie, dont il nous dit, laconiquement:
Et quand il trouvait la mer un peu vide, le Pape inventait des îles…
Nous renvoyant vers une référence de livre dont le titre donne l’eau à la bouche: Lost Islands: The Story of Islands That Have Vanished from Nautical Charts, University of British Columbia Press, 146 pages, 1984.
Dans ce livre, il n’est pas seulement question du Gulf-Stream, mais des courants en général et de leur formation, expliquée soit par la météorologie, soit par le dessin du fond marin, soit par la géographie entreprise sous un angle logique. Aussi lorsque Orsenna nous raconte une anecdote, alors qu’il partageait encore les secrets d’alcôve de l’Elysée, racontée par le vice-amiral Pierre François Forissier, on tombe de haut. L’auteur demande au marin comment les sous-marins utilisent les courants. L’homme de mer lui raconte une histoire, une histoire remontant aux Phéniciens qui s’étaient déjà rendus compte que le détroit de Gibraltar, ce goulet qui marque l’entrée de la Méditerranée, était profondément battu par des courants marins forts. Aussi, pour pouvoir affronter les vents violents venant de l’Ouest et les courants de surface concomitants et ainsi passer le détroit, les Phéniciens ont plongé les mains dans l’eau, ou plutôt leurs amarres, et ils se sont rendus compte qu’avec la profondeur, un puissant courant entraînait l’amarre à contre-courant, d’est en ouest. La solution était toute trouvée. Ils allaient accrocher des sacs de pierres à leurs bateaux, se laissant ainsi traîner par le courant, plus fort que le courant de surface et le vent conjugués.

L’homme n’est pas avare lorsqu’il s’agit de partager son savoir, il nous invite à voyager et à découvrir des courants au nom aussi exotiques qu’oniriques: le Saltstraummen[4], le Corryvreckan [5] ou le Old Sow Whirlpool[6]. Voici le trio de têtes des courants marins les plus violents du monde. Sans parler du Fromveur, plus proche, qui parcourt l’extrémité de notre Finistère.
Le livre est tout de même un peu alarmant, sans être alarmiste et nous met devant dees conclusions qui peuvent faire peur. Le Gulf-Stream nous réchauffe, mais qu’adviendrait-il s’il cessait de couler dans notre direction ?
Liens:
- Le portail des sous-marins
- Le club des Argonautes
- Gulf Stream sur Wikipedia
Notes
[1] Auteur de l’excellentissime Vie et mort de l’image, Une histoire du regard en Occident
sur lequel j’ai passé un peu temps pour mon mémoire de maîtrise.
[2] Découvert au hasard d’une promenade dans la rue de Morlaix où l’on peut voir une des plus célèbres maisons à Pondalez.
[3] A cette lecture, je ne peux m’empêcher de faire un rapprochement avec l’Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari. Oser une lecture deleuzienne d’Orsenna est peut-être gonflé, mais la dynamique des flux, cet amour prononcé pour les courants me fait penser aux flux deleuziens, aux flux coupés, notamment lorsqu’il est question de cette initiative pendant la guerre qui consistait à vouloir construire une muraille pour couper le Gulf-Stream et refroidir le climat européen.
[4] Au large des Lofoten, Norvège
[5] Aux alentours de l’Île de Jura, dans les Nouvelles-Hébrides, Australie
[6] Au Nouveau-Brunswick, Canada


 Maison d’une grande originalité construite près d’un lac dans un lieu boisé et très reculé du centre de la Finlande, c’est le siège d’un champ d’expérimentation dédié entièrement à l’architecture moderne.
Maison d’une grande originalité construite près d’un lac dans un lieu boisé et très reculé du centre de la Finlande, c’est le siège d’un champ d’expérimentation dédié entièrement à l’architecture moderne.

 En ce moment, je pense à l’écriture, au fait d’être sexué de l’écriture. Je pense aussi à tout ces relents de cours de fac, caché au fond de la salle à rêver en écoutant d’une oreille distraite le long flot de paroles du prof, n’en tirant que de temps en temps une substance étrange et compacte. Et puis je me dis que ce n’est pas la vie qui va s’emparer de moi, mais moi qui doit la serrer fort dans mes mains. Rien à voir. C’est comme ça. Je commence à présent à sentir ma chair être envahie de cette tension vitale qu’est le désir et la corporéité. Un mot me revient, Körperlichkeit… Une notion fondamentale dans la philosophie des XIXè et XXè siècles. La corporéité, le fait d’être une chair, un savant entrelacs de corps et d’esprit, qui seraient rendus fous l’un sans l’autre. Je trouve cela d’une beauté excessive, comme j’aime la beauté. C’est ni plus ni moins que l’énergie sexuelle qui oriente l’écriture, lui donne l’impact, la force, la brutalité et la violence. C’est ce qui la valide, l’estampille et l’honore. Si elle n’est pas marquée par la chair intime, elle n’est rien, complètement vidée de sa substance, corps sans vie… Voici le véritable Art de la Faim, celui qu’exerce le vagabond affamé. L’écriture est comme moi, faite pour choquer, pour heurter, rendre sensible, pour exacerber, rendre le jugement difficile et faire passer le convenu pour de la merde. A l’encontre de toutes les conventions, tout le temps. A la fin, je me dis que personne ne peut être moins catholique que je ne le suis… Qu’on me fasse taire, qu’on me tabasse une bonne fois pour toutes, qu’on fasse saigner mon visage pour qu’enfin je ne dise plus rien… De la tuméfaction nait toujours la rancoeur du corps.
En ce moment, je pense à l’écriture, au fait d’être sexué de l’écriture. Je pense aussi à tout ces relents de cours de fac, caché au fond de la salle à rêver en écoutant d’une oreille distraite le long flot de paroles du prof, n’en tirant que de temps en temps une substance étrange et compacte. Et puis je me dis que ce n’est pas la vie qui va s’emparer de moi, mais moi qui doit la serrer fort dans mes mains. Rien à voir. C’est comme ça. Je commence à présent à sentir ma chair être envahie de cette tension vitale qu’est le désir et la corporéité. Un mot me revient, Körperlichkeit… Une notion fondamentale dans la philosophie des XIXè et XXè siècles. La corporéité, le fait d’être une chair, un savant entrelacs de corps et d’esprit, qui seraient rendus fous l’un sans l’autre. Je trouve cela d’une beauté excessive, comme j’aime la beauté. C’est ni plus ni moins que l’énergie sexuelle qui oriente l’écriture, lui donne l’impact, la force, la brutalité et la violence. C’est ce qui la valide, l’estampille et l’honore. Si elle n’est pas marquée par la chair intime, elle n’est rien, complètement vidée de sa substance, corps sans vie… Voici le véritable Art de la Faim, celui qu’exerce le vagabond affamé. L’écriture est comme moi, faite pour choquer, pour heurter, rendre sensible, pour exacerber, rendre le jugement difficile et faire passer le convenu pour de la merde. A l’encontre de toutes les conventions, tout le temps. A la fin, je me dis que personne ne peut être moins catholique que je ne le suis… Qu’on me fasse taire, qu’on me tabasse une bonne fois pour toutes, qu’on fasse saigner mon visage pour qu’enfin je ne dise plus rien… De la tuméfaction nait toujours la rancoeur du corps.
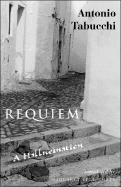 En 1992, Antonio Tabucchi a écrit un livre d’une rare beauté. Ecrivain italien, il est également spécialiste de littérature portugaise et traducteur de Fernando Pessoa, mais ce livre écrit en 1992, Requiem, n’est pas écrit dans sa langue natale mais en portugais. Comme Beckett ou Ionesco, Tabucchi est passé par cet exercice de déterritorialisation de la langue en insufflant dans son texte une matière externe pour créer ce qu’il appelle une
En 1992, Antonio Tabucchi a écrit un livre d’une rare beauté. Ecrivain italien, il est également spécialiste de littérature portugaise et traducteur de Fernando Pessoa, mais ce livre écrit en 1992, Requiem, n’est pas écrit dans sa langue natale mais en portugais. Comme Beckett ou Ionesco, Tabucchi est passé par cet exercice de déterritorialisation de la langue en insufflant dans son texte une matière externe pour créer ce qu’il appelle une