Angel in the hall of night
Tandis que la train tarde à arriver, je suis déjà drapé par mon univers, rien ne compte plus, même celle-ci qui monte dans le train en remontant sa braguette… Les troupes affluent, ça se bouscule, apparemment, il y a des retards dans le trafic, mais rien ne compte… Je suis chez Jack, les yeux plongés dans ses New-York Scenes en écoutant les rythmes indiens de John Mayall et le train avance, s’arrête, absorbe son flot de passagers au travers des gares, les corps se chevauchent, s’entrechoquent, se bousculent et ça me fait bien sourire, j’ai le rythme, ça claque dans mon livre et dans mes oreilles… Je m’en fous, j’ai trouvé une place assise dans un coin, sans voisin, je suis presque tout seul dans la foule… Rien ne me touche, juste cette fille qui emporte mon marque-page tandis qu’elle essaie de s’agripper à la rambarde… et je me retrouve à nouveau dans le métro, je suis quelqu’un qui monte dans une rame pas trop bondée, et je me retrouve face à une dame au nez pointu qui semble en extase devant un ange, un ange – hall of night – à la peau blanche et au regard candide au travers de ses grands yeux verts qu’on croirait sortis d’une bande dessinée japonaise… comme si elle était perdue, elle regarde partout autour d’elle, ange tombé là par hasard… la lumière du soleil dans l’axe de la rue…
L'odeur des dunes dans une chambre blanche
Je m’étais toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler une rencontre avec la gloire. Un doux moment lénifiant à l’image d’un verre de lait passant dans la gorge ? Un courant électrique parcourant l’échine et rendant encore plus fort ? Ou bien quelque chose de purement charnel confinant à l’orgasme ? Toutes mes opinions ont volé en éclats lorsqu’un jour ça m’est tombé dessus, et je dois avouer que je n’avais pas envisagé que ça puisse être douloureux. Une des raisons pour lesquelles ça m’a fait si mal, c’est que j’étais allongé sur un lit d’hôpital, souffrant, pour ne pas dire souffreteux. Je pensais que connaître la gloire était un phénomène qui mettait du temps à se mettre en place, que ça devait ressembler à l’édification d’une cathédrale (même si ça ne dure peut-être pas aussi longtemps une fois que c’est construit), mais dans mon cas, j’ai tout pris dans la figure alors que j’étais en train de me faire enfiler un thermomètre là où paraît-il, où paraît-il…. Enfin bref. Je lisais le journal en même temps. Les pages culture
. Et qu’est-ce que je prends en pleine tronche ? Ma photo, une photo sortie de je-ne-sais-où, un truc immonde représentant mon profil, avec mon nez busqué d’Indien des plaines et mon faux sourire barré d’un rictus moqueur que je ne me connaissais pas. Je n’ai jamais su qui avait pris cette photo, ni où c’était, mais au vu de la foule qui défilait derrière, je dirais que ça devait être dans un café, ou un restaurant. Au-dessus de la photo, il y avait un grand titre qui devait raconter un truc dans le genre La nouvelle coqueluche des milieux branchés
. Une belle surprise quand on est en train de sa faire fouiller le fondement par une grande infirmière qui ne peut s’empêcher de lire par-dessus (non pas l’épaule) le drap. Elle m’a crié dans l’oreille. Mais c’est vous ça ! Ben oui, il semblerait, lui répondis-je. Vous êtes écrivain ? Z’avez pas l’air d’un écrivain ! Je lui dis: en même temps, c’est clair qu’avec le cul à l’air et toutes ces saloperies que je traîne, je ne ressemble pas à grand chose, et puis d’abord, ça ressemble à quoi un écrivain? Vous en avez déjà vu ? Nan, mais vous avez pas une tête d’écrivain, c’est tout, vous fâchez pas, répondit-elle. Je n’ai rien répondu, ça ne valait pas le coup. J’essayais de lire. Je voulais voir ce que ces scribouillards avaient écrit sur ma prose. En gros, le type qui avait écrit ça me traitait de nouvelle coqueluche tout ça parce que les quelques nouvelles que j’avais publiées ça et là dans des revues littéraires avaient attiré l’attention de petits groupuscules élitistes proches des maisons d’édition. Ce n’était pas que j’avais espéré. Il attirait l’attention sur mon style sans retenue, ma grossièreté et l’absolue absence de métaphore, me comparant à un type dont je connaissais même pas le nom, un écrivain américain de seconde zone, certainement. Bref, j’avais passé le cap de la première critique merdeuse et sans consistance. Heureusement que je n’ai jamais écrit un seul poème, sinon, il y a bien longtemps que je me serais fait descendre. La poésie, cette bâtarde de l’enfer qui détruit les hommes et les rend serfs de règles absurdes… Je me marrais tout seul en tenant mon canard d’une seule main. Bon c’est terminé, là ? lançais-je à la grande haridelle qui me tenait toujours par le bas.
2. Voilà, je suis sorti de l’hôpital, le portefeuille plus léger et un beau dossier médical me diagnostiquant une infection urinaire, une saloperie qui me faisait pisser des lames de rasoirs et grâce à laquelle j’avais rempli plusieurs bocaux de mes substances. Un souvenir pour l’assistance publique. En sortant du Val de Grâce, je me retournais sur le planton à l’entrée et je lui dis de prendre soin de mes déjections, elles vaudraient un jour de l’or ! Il me dévisagea d’un regard bovin et me demanda de circuler. C’est ça ! Et que je ne vous revoie pas, lui lançai-je. J’étais redevenu libre. L’armée m’a gardé enfermé pendant une semaine dans ses murs à examiner mon corps sous toutes ses coutures, à me faire passer dans les salles de radiographie, j’ai eu le droit à tout. Le bassin, les reins, l’abdomen et même un joli panoramique dentaire ! Mais foutez-moi la paix ! J’ai mal quand je pisse, pas quand je mange ! Mais Monsieur, si vous avez une infection dentaire, ça peut générer une infection urinaire, me répondit la gravure de mode masculine gominée qui m’a fait prendre des positions pas possibles, alors que je souffrais le martyr en essayant de retenir le litre et demi d’eau que j’avais bu pour l’occasion. J’étais donc à nouveau libre. Libre et bourré de médicaments. Il était un peu plus de huit heures du matin, et comme j’avais refusé d’absorber l’immonde café qu’on m’avait proposé à ma sortie, j’ai pris le parti de remonter le Boul’Mich pour m’asseoir à une table près de la Seine, avec café et croissant dans un vrai café, avec la bonne odeur qui va avec et cette ambiance de Paris au matin. Avant d’y aller, je passais dans une papeterie non loin de là pour acheter un bloc de papier à carreau et un stylo. Une semaine auparavant, j’étais entré dans ma chambre d’hôpital en apprenant que j’étais là pour une semaine, alors que je n’avais même pas un caleçon de rechange dans la poche. Je n’avais donc sur moi qu’un petit carnet sur lequel j’ai essayé d’organiser mes idées de la façon la plus compacte, et cette restriction d’une semaine avait comme fortement affecté ma liberté d’épanchement. Avec de quoi écrire, je me sentais neuf et prêt à repartir. Avec la force d’un jeune cheval, bride rabattue, j’appelais la serveuse, la pétasse qui nettoyait les tables alentour. Un double expresso, ma jolie ! Elle me toisa et partit faire chanter le perco avec un air renfrogné. Jamais contentes ces serveuses. Encore une chance que je ne lui fit pas claquer la main sur les fesses… Des miettes de croissant se battaient dans les poils de ma barbe de sept jours et je descendais les gorgées chaudes de mon café, en respirant l’air déjà enfumé du lieu, avec l’impression de commencer à revivre. Une semaine dans l’enfer blanc, privé de tout ce qui se passe dehors… De quoi écrire et je me sens à nouveau libre. Parler de tout et de rien, parler des gens qui passent, parler de sexe ou de politique, je n’aime que ça. J’étais redevenu libre et désormais, j’allais montrer à tous ces idiots que je n’étais pas un écrivain de quartiers branchés, que je valais mieux que ça. A partir de ce jour, ils allaient devoir me regarder comme un écrivain, parce que mon roman était en train de s’écrire sous mes yeux.
3. Trois semaines ! Trois bon dieu de semaines passées dans les salles de cafés tous plus bondés les uns que les autres, dans le bruit et la fureur du quotidien qui défile ! Trois bon dieu de semaines pendant lesquelles j’ai mangé des jambons beurre cornichons et que mon budget ne cessait de fondre comme beurre au soleil. Trois vilaines semaines pendant lesquelles j’ai eu froid et j’ai eu froid, et encore froid, les veines remplies de sang noir couleur café sucré, excité et pantelant comme un cheval au galop, des jours et des jours passés à griffonner mes idées, à les biffer, à tenter des bouts de paragraphes, à essayer de poser du style, à remplir des lignes que je finissais toujours par tailler, pour ne garder que l’essentiel. J’étais presque prêt à tout ordonner. J’avais sous les mains cinq cents belles pages empilées que je trimbalais sous le bras partout où j’allais, de cafés en bistrots, de parc en parc, la pile me suivait et l’angoisse de perdre ne serait-ce qu’une feuille me tordait les intestins. Alors je me suis acheté une espèce de vieux cartable chez un bouquiniste pour entasser le tout. C’était numéroté, pas besoin de classer, je voulais simplement ne rien perdre. Je savais pertinemment que sur les cinq cents pages, je n’allais en garder que deux cents que l’éditeur se chargerait avec amour d’amputer encore de tous les moignons qu’il jugerait superflus. Relire encore et toujours, à chaque fois je trouvais des fautes d’orthographe, des accents circonflexes partout et aucun là où il en fallait, je désespérais sans cesse d’avoir un jour un écriture qui me permette de ne pas avoir besoin de me relire. Fait chier cette langue dans laquelle j’ai fait mon nid. Mais tellement fluide. Bon. De toute façon ils ont des correcteurs dans les maisons d’édition, non ? Ce cartable, je le trainais partout avec moi, jusqu’aux toilettes. Ma plus grande crainte était de le perdre et je pensais que l’endroit où il était le plus en sécurité, c’était près de son maître. Et puis je me suis battu. Comme ça. Tout ça parce qu’un mec me faisait chier. C’était un soir à la Guillotine[1]. J’étais assis avec mon pote Yan, le musicien et on discutait ferme autour d’une bière. Je lui faisais part de mes incertitudes quant à ce que je devais garder ou pas dans le texte.
Des conneries en fait, parce que lui s’en foutait complètement. Je l’ai saoulé avec mes mots, et moi je me suis saoulé à la bière. Je devais être un peu trop bourré parce que je parlais fort et les gens, tous ces abrutis, me regardaient avec force mépris – ou alors c’était la parano de l’alcoolique – et apparemment, ça dérangeait certains d’entre eux qui n’arrivaient pas à écouter les accords foireux d’un Bob Dylan toujours égal à lui-même, plat et sans intérêt. Je faisais des grands gestes et des moulinets ridicules, comme si parler littérature nécessitait de l’espace, et je me mis à déclamer un vieux poème de Burroughs, ce qui devait donner la même chose que lorsque l’auteur avait écrit ces mots, c’était pitoyable. Un gars qui était assis derrière moi me tapa sur l’épaule d’un index pointu et me demanda si je connaissais le concept d’ultraviolence. Il avait un visage épais et répugnant, des lèvres rouges et luisantes, et portait dignement une espèce de coiffure de bourgeois ankylosé, le tout porté par un blazer rapé, un jean avec des revers et des mocassins passés sur des chaussettes blanches. Grande classe. Hey ta gueule toi ! Qu’est-ce tu me fais avec ton truc là ? T’as pas digéré ton Orange Mécanique ? Même pas capable de penser par soi-même, t’aurais pas pu inventer un truc tout seul, non, faut que t’ailles puiser chez Burgess ? Il me répondit: Il va se calmer ce con ? Et puis c’est qui ce Burgess ? Yan et moi nous nous sommes regardés et les larmes nous vinrent aux yeux, nous nous sommes écroulés de rire, tout bourrés que nous étions. Evidemment, il n’a pas aimé, il m’a retourné une droite dans l’estomac et je me suis écroulé par terre, la gueule sur la tomette, le souffle coupé à la faux. Je n’aime pas rester sur un échec. Alors j’ai repris mon souffle, tranquillement pendant que l’autre abruti se rasseyait. Et puis je lui ai gentiment poussé la tronche en avant, histoire qu’il embrasse son verre. S’est ensuivie une bataille rangée et générale dont je ne suis encore à ce jour pas peu fier. Yan et moi avons fini sur le trottoir, beurrés comme des coings et les mains ensanglantées, mais qu’est ce qu’on s’est marré ! Comme par enchantement, le cartable était posé à mes côtés, tout près de ma joue qui collait au bitume. Celui qui m’avait flanqué dehors avait eu la délicatesse de me raccompagner avec mes effets. J’ai beaucoup apprécié.
Notes
[1] La Guillotine est en réalité le caveau des oubliettes, rue Galande dans la quartier latin.
4. Si je réussissais à vivre sans travailler, c’est tout simplement que j’avais réussi à amasser quelques deniers en vendant mes premiers textes ça et là, ici dans un journal, ici dans une revue, ici à diverses personnes que j’avais connues par relations et qui couraient après des manuscrits pour en faire je ne sais quoi. Ce que je leur avais vendu ne valait pas tripette et je préférais disperser mes écrits dans la boue et me faire du fric plutôt que de garder tout ça religieusement pour en faire des confitures. Au moins, j’avais la possibilité d’errer les poches pleines d’argent frais, dont je pouvais disposer pour vivre le temps de composer quelque chose. Je dormais chez des amis ou à l’hôtel, chez des gens peu regardants sur le fait que je squatte une nuit ou deux. Mon réseau de relations à Paris était étendu. Je connaissais un poète via mon ami Yan, qui lui-même connaissait pas mal de monde dans les milieux aisés. Je gardais des appartements grandioses pendant que leurs rupins de propriétaires se faisaient dorer la couenne sur la Riviera (on dit toujours ça ?) ou aux Maldives. Je ne dépensais pas grand chose, juste de quoi me nourrir, j’achetais des feuilles par ramettes entières et quelques crayons. Une vie de pas grand chose dans la plus belle ville du monde. Je n’existais plus pour personne. J’étais juste un numéro pour la Sécurité Sociale, mais je n’avais plus de compte en banque, plus de factures à payer, rien à devoir à personne, et cette liberté chèrement acquise était pour moi mon meilleur atout. Je ne faisais qu’errer dans une ville où je trouvais le plus clair de mon inspiration. Avoir des chaînes aux pieds m’empêchait d’écrire, impossible de faire quoi que ce soit avec des contingences. L’esprit et le corps libre.
A ce moment, je vivotais dans un vaste appartement sur l’île Saint-Louis. J’aurais pu trouver plus dégueulasse. Jonas, l’ami de Yan m’avait dégoté ce petit job qui consistait uniquement à ouvrir les volets le matin, et à les fermer le soir, chez un couple de journalistes qui avait décidé de prendre quelques mois la tangente pour s’immerger dans la civilisation népalaise. Très bien. En échange de cette garde prolongée, j’avais accès à une douche, un lit que je tentais de garder propre, une cuisine, bref, tout le confort que je ne pouvais pas me payer. J’étais bien dans ma peau. Vraiment très bien. Je jouissais fortement de tout ce que j’avais. Pendant toute cette période, je vivais presque reclus dans mon monde, uniquement bercé de mes mots, de mon inspiration, de mes illuminations fidèles. De temps en temps, je me saoulais avec mes amis, histoire de décrasser la bécane. Mais il n’y avait pas de femme dans ma vie depuis un bon bout de temps, peut-être un an, certainement plus. Mon roman était en phase intense de fignolage et la pression retombant, je m’aperçus d’un seul coup que mon corps criait famine, il voulait du sexe. Je ne m’étais pas non plus rendu compte à quel point je ne prenais plus soin de moi. J’avais les cheveux longs et la barbe au menton, mes vêtements étaient râpés. Je ne ressemblais plus à rien alors que je ne m’étais jamais senti aussi bien, et le fossé qui s’était creusé entre l’intérieur et l’extérieur commençait formellement à me déplaire.
Alors, j’ai traîné ma carcasse dans les grands magasins qui jalonnent les quais de Seine et j’ai craqué sur quelques petites choses chères mais qui me faisaient tout de suite plus ressembler à un personnage séduisant qu’au clochard que j’étais en réalité. Je suis passé chez le coiffeur (j’ai même réussi en insistant à me faire raser, ben oui, ils sont où les barbiers ?) et avec mon pantalon noir et ma chemise blanche, j’avais des allures de Kerouac sur les photos les plus connues. Ouais, je me sentais beau. J’ai tout de suite repris beaucoup d’assurance et je pouvais désormais traîner dans les cafés en regardant les gens sans honte. Je ne savais plus faire ça. Il commençait à faire beau. Paris renaissait sous mes yeux. J’avais une formidable envie de terminer ce que j’étais en train de faire, mais aussi de faire l’amour.
C’est alors que je l’ai rencontrée.
5. Apprends à lire avec un crayon de papier (crayon à papier, mine, crayon de bois), porte-le à ton côté à chaque fois que tu parcours une ligne, que tu imprimes sur l’oeuvre ta lecture, car il te manquera quelque chose à chaque fois que tes yeux passerons à nouveau sur la tranche parmi les autres livres de ta bibliothèque. Tu ne te souviendras plus, tu auras oublié. Le crayon est là pour t’aider, n’hésite pas à souligner, encadrer, biffer, caviarder, à noter dans les marges, elles sont là pour ça, à inscrire sur la page de garde le numéro de la page qui renvoie à la page qui t’intéresse. Lis avec lui, il sera ton indéfectible compagnon. Apprends à lire avec un crayon, tu donneras à ton livre une vie qui lui manque et qu’il n’aurait pas sans toi, tes yeux, ta lecture et ton crayon. Qui m’a dit ça déjà ?
6. Ah ah. J’adore les femmes. Bon, faut être con pour dire le contraire, quand même. C’est vrai qu’elles n’étaient pas au centre de mes préoccupations du moment. Je ne pensais pas qu’il était possible de ne vivre que pour l’écriture, et ce que je vivais ces derniers temps avait tout l’air d’un rêve long et bienfaisant, quelque chose qui coule dans les veines comme un vin béni et transporte vers des paysages d’une pureté sans nom. Bref. J’avais gagné en confiance en moi, j’étais devenu fort, les traits de mon visage s’étaient durcis, comme si chaque sillon, chaque ridule portait en soi un moment de mon existence exposée à présent à la face du monde. Mes amis me trouvaient changé. La barbe et les cheveux recouvraient mon visage comme une chrysalide les ailes d’un papillon qui ne demandait qu’à voler.
Un jour d’avril, alors que les premiers beaux jours avaient enfin daigné se pointer, j’avais décidé de me poser toute une journée sans travailler. Passerelle des Arts. La brüme d’un petit matin. J’ai avisé un banc solitaire et j’ai posé mon cul. L’air était chargé d’un mélange d’effluves de harengs fumés et de verdure fraîchement coupée, cette même odeur d’herbe coupée qui montait jusqu’au balcon de mes grands-parents, lorsque le soleil frappait fort et que j’étais vautré devant la télé à regarder les matches de Roland Garros. Quelle digression !
Les gens du matin ont une fraîcheur particulière. Peut-être celle du gant de toilette, va savoir ! Toujours est-il que pour le première fois depuis longtemps, j’avais envie de poser sur le monde un regard nouveau, mon cartable bondé à mes pieds, les fermetures en laiton prêtes à péter .
Un type s’est assis à côté de moi, un Japonais. Il portait sur le visage les stigmates d’une sombre félicité, simplement barrée d’un léger tic sur la lèvre supérieure. J’aurais aimé avoir ce genre de regard, ce visage lisse, sans nuages, mais je savais pertinemment que le mien ne ressemblerait jamais à ça.
Bon, il faisait un peu frais quand même. Je rabattis le col de ma veste pour feiner un peu le vent. Même avec la fraîcheur, j’avais comme des sueurs froides et je transpirais pas mal des aisselles. Ma chemise était trempée.
J’étais au milieu de la passerelle.
C’était calme et bon.
C’était doux.
Et puis il y a toujours un trublion qui vient dans la parage pour mettre le souk. Celui-ci était une sorte de grand escogriffe tout droit sorti d’un roman de Léo Malet, les cheveux gominés et portant un costume d’une couleur indéfinissable, le faisant plus ressembler à un pégriot qu’à n’importe quoi d’autre. Il parlait fort avec son téléphone portable. Tableau improbable et décalé. Et puis, c’est plus fort que moi, je ne pouvais pas rester là à ne rien dire, surtout calmement. Heu dis-donc machin, tu veux pas aller pousser la chansonnette sur les quais, là, peut-être que tu arriveras à arracher de la thune ? Il m’a regardé avec un air méchant qui ne me disait rien de bon, toujours le téléphone collé à l’oreille. Pas envie de me battre si tôt. Alors finalement c’est moi qui ait changé de banc.
Le Japonais s’est levé aussi et s’est assis à côté de moi.
Elle était accoudée au garde-corps. Désinvolte et provocante. Un corps parcouru de courbes étonnantes que je devinais aisément sous des vêtements qu’elle remplissait à merveille. Je ne sais pas pourquoi, c’était peut-être le moment ou alors elle, ou alors l’ordre du monde qui s’est soudain modifié pour que l’on se rencontre, mais il fallait absolument que je m’approche d’elle, rendu tout à coup fou par une secousse sismique. J’observais son corps ondulant et ses cheveux. Quelque chose d’indéfinissable en elle m’attirait, attirait mon regard. Alors je me suis levé et j’ai été frappé par son odeur, un parfum sensuel qui appelait à se damner. Une furieuse envie de la prendre et de ne pas la rendre à son propriétaire… Tout en elle respirait à la fois violence de l’enfer et douceur du velours. Bref, c’est bien beau les métaphores, je pourrais parler des heures sur elle, écrire des histoires et composer des poèmes à l’eau de rose, mais ce n’est pas aller au coeur des choses. Elle sentait le sexe à plein nez. Et à ce moment-là c’était le seul truc auquel je pouvais penser. Les mots, les pages, le livre, tout ça me sortait pas les yeux, je voulais faire autre chose. Alors je me suis mis à lui parler…
7. On prend tout et on recommence. Je me suis assis à la table du coin, une petite table carrée et bancale dans le coin derrière la devanture vitrée du café de la mairie, juste sous le nez des passants qui arpentaient la place Saint-Sulpice, peut-être même la même table à laquelle était assis Georges lorsqu’il tenta d’épuiser le lieu[1], enfin, rien n’est moins certain. Il faisait bon, il y avait un beau soleil argenté. J’ai placé la pile devant moi et j’ai entrepris de tout recopier, histoire d’en faire une version définitive. J’avais sous les yeux quelques semaines de travail, enchevêtrées dans tous les sens, dans un ordre que moi seul connaissais, une sorte de chateau de cartes que j’allais tenter de ne pas faire tomber. Chapitre un, c’est fluide, ça coule tout seul. C’est plein d’une force que j’ai mis des années à construire. Avant cette période, je suis resté quelques années sans réellement écrire, griffonnant quelques bribes ça et là, mais je n’y arrivais plus. Les forces m’avaient abandonné et je maudissais tout ce qui m’avait fait perdre ce souffle que tous ceux à qui je faisais lire mes textes trouvaient vraiment particulier, comme si j’avais mon empreinte déjà dessinée depuis ma naissance. Chapitre 2, c’est bon ça, ça se lit tout seul, rien n’accroche. J’ai tout recopié. J’ai extrait de sa gangue de boue et d’argile quelque chose qui ressemblait à de l’or, un beau lingot effilé à la couleur aveuglante. Quel prétentieux je faisais ! Rien à foutre, je n’étais pas là pour amuser la galerie, j’avais en moi la force du lion bondissant sur la gazelle avec un air triomphant, tout ça pour bouffer. Au bout du compte, c’est bien ce que je voulais. Vivre de mon écriture, faire de ça mon boulot alimentaire à moi, croquer avec mes mots. J’allais y mettre toutes mes tripes. Ces petits scribouillards qui m’avaient fait passer pour une icône de la branchitude parisienne allaient pouvoir se rendre compte que j’avais dans les boyaux de quoi les faire taire et rester muets devant mon oeuvre, ils allaient pouvoir se prosterner devant moi, déposer des cierges au pied de Notre-Dame et scander mon nom dans leurs litanies les plus intimes. Merde. Non. J’étais en train de composer mon oeuvre, pas celle des autres. Reste humble mon connard, me disais-je, alors que je continuais sans encombre mon travail de copiste.
J’essayais de ne pas penser, de m’enfermer dans une bulle. Seul le bruit du percolateur arrivait de temps en temps à me sortir de ma torpeur salvatrice, mais je replongeais aussitôt dans mon écriture, jetant les pages par terre lorsque j’en avais extrait la sève. Bordel, j’étais heureux, je m’adonnais au plus beau de tout les métiers.
Un café, un autre !! Un chocolat ! Je passais commande au rythme des heures qui passaient, ne voyant plus que des lignes partout, mon écriture hachée sur la vitre, sur le visage des passants et sur celui du garçon de café… Des lignes sur ma tasse de café…
A la fin de la journée, tandis que les ombres commençaient à s’allonger et que la lumière prenait des teintes orangées, j’avais recollé tous les morceaux, je m’étais livré à un travail de fourmi, rapide et bien orienté, à la fin duquel je pouvais enfin tenir entre les mains mon bouquin. Il était là et se découpait dans la lumière du crépuscule, avec la fontaine Saint-Sulpice en toile de fond, on aurait pu prendre une photo, tiens !
Notes
[1] Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien
8. J’ai peur d’avoir mal…
Un mal qui ne s’efface pas.
9. On s’était parlé à peine plus de dix minutes, après quoi elle avait du partir, je ne sais pour quoi. Il était tôt et elle avait fui comme une anguille, sans rien me dire d’elle, je n’avais même pas son numéro de téléphone, rien, pas la queue d’un indice pour que je puisse la retrouver. Tout ce que je savais c’est qu’elle s’appelait Lily, ou quelque chose comme ça, peut-être Lilith, déesse de l’enfer sur une toile de Bosch, tentatrice extrême et beauté rude… Je n’avais pas réussi à bredouiller plus que de banales sottises, des idioties dont j’avais honte. Elle n’avait pas beaucoup parlé… je ne savais rien d’elle… j’étais furax de m’y être pris comme un manche et j’étais quasiment certain que je ne lui avais pas laissé un souvenir impérissable, et j’étais persuadé qu’on ne se reverrait jamais. Il aurait fallu que je retourne sur la passerelle, au petit matin, mais j’avais tellement peu d’espoir que je laissais tomber et que je me replongeais dans la vie tellement passionnante du célibataire en goguette sur les bords de Seine. La dernière fois que je m’étais pris ce genre de veste – il faut tout de même dire que je ne suis pas, que je n’étais pas, un guerrier, plutôt du genre à attendre sur le bord de la route qu’une bimbo me prenne en auto-stop dans sa Ford Mustang – , c’était sur les bancs de la fac, ou plutôt du métro. J’étais assis en face de cette fille splendide – d’accord, ça n’engage que moi – au regard sombre, la mine voilée d’une romantique tourmentée, cachée derrière le col de son caban. Je suis certain que personne ne la regardait parce qu’elle était peut-être un peu trop discrète, et revêche de prime abord, mais tout en elle respirait l’intelligence et la grâce, quelque chose de sophisitiqué qu’on ne pouvait voir qu’au travers d’un prisme dont j’étais le seul à comprendre la diffraction. Je n’arrêtais pas de la regarder, assis penaudement sur mon strapontin branlant, et à chaque fois qu’elle levait le nez de son livre, elle passait la main dans ses cheveux courts, me regardait furtivement, et elle me souriait gentiment, l’air de dire Oui, c’est bon, je t’ai vu, mais t’es vraiment pas mon genre, j’aime les hommes qui peuvent me tenir fort dans leurs bras et me faire vibrer fort
, ce qui m’a fait comprendre qu’il ne fallait pas que je m’esquinte inutilement. Nous allions au même endroit, je suppose, Jussieu, le cours sur Saint-Paul, mais arrivé devant l’amphitéâtre, je tournai les talons et je pris le parti d’aller me saouler à la tequila dans le premier café, ce qui à vingt et une heure et aux abords d’un des temples du savoir français peut paraître un tantinet décalé. Bref.
Pour la première fois depuis que je l’avais acheté, je laissais mon cartable, non sans quelque appréhension, dans l’appartement. Ben oui. On ne sait jamais, si l’immeuble avait crâmé, ou si l’ÃŽle Saint-Louis avait tout à coup décidé de retourner dans les entrailles de la terre, mon oeuvre se serait trouvée anéantie, perdue pour le reste de l’éternité… En même temps, je n’allais pas déposer le tout dans un coffre. Donc, je disais, je laissais mon cartable passablement amaigri sur le lit. Le reste, les brouillons, le rebus, les pages biffées, j’avais tout confié à Yan, ce qui n’était pas forcément un gage de sérieux de ma part, mais en l’absence totale de lieu d’habitation fixe, je n’avais pas vraiment d’autre choix. Et donc, j’avais décidé de sortir. Jonas organisait une petite soirée mondaine, mais il avait également eu le tort d’inviter la troupe de zazous de mes amis de fac. Yan, Pierre et Sullivan faisaient partie du lot et c’est bras dessus bras dessous – et surtout complètement torchés – que nous nous sommes incrustés dans son six pièces avec vue sur la mer – la Seine ? Je crois définitivement qu’il avait décidé de faire un concours avec lui-même pour voir jusqu’à quel point il pouvait être con, parce que nous réunir, nous, jeunes trentenaires dépravés, célibataires et passablement portés sur la bouteille, dans la nuit parisienne au milieu d’artistes et d’écrivains, ça tenait réellement du prodige d’inconscience ! Pas grave. C’était bien parti pour une bonne tranche de rigolade, voire même plus. On aurait dit des beatniks en pleine forme.
Quand nous sommes arrivés, il régnait une ambiance feutrée, douce, bercée par une mélopée électro, du style de celle qu’on entend dans les restos branchés. Agréable. Mais surfait. Tout le monde était debout, un verre à la main, et ça discutaillait ferme, mais quand on est entrés, nos quatre voix – aux trémolos évocateurs chantant la Bohème de Monsieur Aznavourian et ne laissant aucune place au doute quant à notre degré d’alcoolisation – éteignirent les conversations comme le sable recouvre le feu. L’appartement était d’une taille indécente, entièrement dessiné par des designers en vogue, tapissé de moquettes écrues et moëlleuses, recouvert de peintures claires et bardé de larges baies vitrées. Ce que je préférais chez lui, c’était ces larges canapés dans lesquels on ne pouvait faire autrement que de s’avachir, au cas où on ne tienne pas debout, ou en cas de chavirage subit.
– Bon et sinon ? Eh ho !! Romuald ! me lança Sullivan alors que je tentais d’attraper la cerise qui flottait dans mon punch.
– Quoi ? Attends bordel, j’arrive pas à l’attraper! Quoi ?
– Bon t’en es où de ton bouquin, là ? Y’a des chances qu’on puisse le lire avant Noël ?
– Tu sais, c’est marrant ce que tu me dis, parce que j’avais même pas penser à vous le faire lire ! C’est con hein ? J’ai donné mes brouillons à Yan et je ne lui ai même pas proposé ! J’te jure…
– Ouais enfin personnellement j’aime pas trop bouquiner les premiers romans, dit Yan l’air très détaché.
– Tu te fous de qui toi? lui rétorquai-je outré. Tu ne lirais même pas ce que j’écris ? J’attendais un peu mieux de toi quand-même ! Non mais ho !
– Comment qu’il part au quart de tour celui-là ? Tu ne vois pas qu’on a tous hâte de te lire ?
Sur ce, Pierre déboula dans les environs, chancelant. Il s’en prit à la grosse qui étaient assise à côté de Sullivan. Il me semblait bien que j’avais déjà vu quelque part ce visage rubicond à la peau vérolée. Peut-être la femme d’un cinéaste, ou d’un éditeur. J’avais déjà du la croiser dans un de ces nombreux cocktails qu’organisait Jonas pour entretenir ses relations de travail.
– Elle va pousser ses fesses la dame là ?
Elle le toisa d’un air méprisant et lui ne tenait plus debout. Bon, elle se casse où je lui gerbe dessus ! Elle a fini par s’en aller en soufflant comme un boeuf, mettant toute son énergie à décaniller au plus vite.
– Rhooo, c’est pas vrai ça ! Bon ! Vous parlez de moi là ? C’est ça ?
– Non, Pierre, on ne passe pas notre temps à parler de toi. Pour une fois c’est de moi dont il est question. Et puis de toute façon que veux-tu qu’on dise à ton sujet ? Tu penses qu’on parle de ta dernière chaude-pisse ?
– Gna gna, éructa t-il.
– Ouais, c’est ça, répondit Sullivan. Il se tourna vers moi avec un grand sourire de faux-cul. Et sinon, quand est-ce que tu penses prendre un peu de bon temps ?
– Qu’est-ce que tu entends par là ?
– Je ne sais pas moi, trouve-toi une fille, profite un peu de la vie !! Honnêtement ça fait combien de temps que tu vis comme un ermite là !
– Ta gueule, répondis-je sèchement, plongeant le regard dans mon verre.
Yan qui jusque là ne pipait pas réussit à l’ouvrir.
– Oh oh !!! Voilà donc le sujet sensible !
– Bon écoutez, c’est un peu compliqué à vous expliquer mais… je laissais ma phrase en suspens et en regardant leur visage, je me dis qu’il fallait peut-être mieux être honnête avec eux.
C’est à dire que je ne peux pas. Pas pour l’instant.
– Comment ça ?, dit Yan en se redressant.
– Tant que je n’ai pas bouclé mon bouquin, je ne me sens pas de penser à autre chose. J’ai un peu peur de tout flanquer par terre. Tu vois, c’est un peu comme si penser à autre chose qu’à ce que je fais revenait à enlever la bonde d’une baignoire pleine à rabord… S’ensuivit un long silence. Une ombre avait du se dessiner sur mon visage, car aucun des trois n’osa poursuivre.
Bon, on reparlera de ça plus tard, non ?
Dehors, la nuit parisienne était chaude, un vrai temps d’été. J’avais l’impression de flotter dans cette ambiance feutrée, m’abandonnant aux vapeurs de l’alcool, me noyant dans le punch. J’écoutais mes potes parler de leurs exploits, chacun se vantant de conneries dignes de collégiens. C’était mon monde, mes amis, tout ce qui m’entourait. La soirée se termina mal, et malgré la présence de personnalités plus ou moins éminentes du milieu intellectuel parisien, je vis tout autour de moi virer proprement à l’orgie. Pierre, passablement murgé dès le début finit assis dans un fauteuil, endormi et incapable de bouger alors qu’il se vomissait doucement dessus, un long filet de bile pendouillant de ses lèvres violettes. Il nous a un peu fait peur, mais on l’a redressé pour ne pas qu’il s’étouffe et il s’est réveillé le lendemain un peu poisseux et puant comme un mareyeur, mais en vie. Sullivan lui était passé, comme deux ou trois autres lascars, entre les cuisses d’une espèce de diva marocaine que j’avais déjà croisé dans une party et qui s’était également tapé la moitié de l’assistance. Yan, lui, en parfait gentleman, avait passé la nuit sur le canapé à ronfler harmonieusement sur sa guitare.
Et moi j’étais parti dans un délire très mince, dans lequel je parlais avec une bouteille de Justerini & Brooks[1], je lui demandai son âge et dans quel état elle était née, etc. La nuit nous emporta tous, et nous nous réveillâmes qui le froc au genoux, qui couvert de vomi, que sais-je encore…. Un vrai bordel.
Notes
[1] JB pour les intîmes
10. Jonas m’a demandé de passer le voir chez lui. Comme par enchantement, les traces du chantier de la veille dont nous avions été les acteurs avaient complètement disparu. Les odeurs également, et il flottait en ces lieux une suave odeur de jasmin – enfin personnellement j’ai toujours trouvé que le jasmin sentait la pisse, mais chacun ses goüts. Je lui avais demandé de me donner des conseils pour faire la tournée des éditeurs, et comme souvent, il me recevait en robe de chambre satinée. Avec ses cheveux gominés et sa petite moustache fine taillée au millimètre, on aurait dit un vieux beau, ou un vieux pédoque.
– Bon, tu sais, je ne suis pas agent et tes histoires là, ça me saoule, mais je suis prêt à faire le nécessaire pour toi. Alors dis-moi de quoi tu as besoin.
– Eh ho, je ne t’oblige à rien, je te demande ça comme un service. Alors tu vas me soigner cette gueule de bois et je repasse ?, dis-je en me levant, un tantinet exaspéré. Je ressentais moi aussi les effets de la veille, et ce soudain accès de fureur fit couler quelques perles de sueur sur les tempes.
– Ne t’énerve, j’ai un peu la gueule de bois, dit-il avec un soupçon de pâleur sur ses joues. Bon alors dans un premier temps, il va falloir que tu me donnes une version définitive de ton bidule. C’est manuscrit ?
– Non, je l’ai tapé avec mes petits doigts et je l’ai fait imprimer.
– Parfait, les éditeurs ne lisent plus les manuscrits, ça finit généralement dans le tas de charbon. Je vais te faire photocopier tout ça en plusieurs exemplaires et je te donnerai ensuite toutes les adresses dont je dispose. Certaines en particulier sont intéressantes et aboutiront certainement à quelque chose de concret.
– Attends, ça veut dire quoi ça ?, demandai-je, légèrement soupçonneux.
– Comment ça, je ne comprends pas ?
– Tu es en train de me dire que certaines adresses sont intéressantes, je ne vois pas ce que tu entends par intéressantes….
– Eh bien, disons que tu auras plus de chances de te faire éditer chez certaines personnes que je connais…
– Ah ouais ! Je vois ! Autrement dit, ce que tu me dis c’est que tu vas me pistonner !
– Bon alors, je t’explique, à moins que t’appelles Modiano ou Djian, tu n’as pratiquement aucune chance de sortir du lot mon coco, parce que, je n’ai pas lu ce que tu as écrit, mais si tu veux mon avis, tu n’as pas le quart de la moitié de leur talent, alors si tu comptes te faire un peu de fric avec ce que tu écris, fais-moi confiance et laisse-toi bercer.
– Comment peux-tu dire que je n’ai pas de talent si… Enfin bref, ce n’est pas la question. Je ne veux pas me faire pistonner pour me faire publier, c’est quoi ce bordel ? Alors ça fonctionne comme ça ? Merde alors, moi qui pensais que le milieu littéraire était une sorte de bastion que le fric n’avait pas encore touché.
– Oui, effectivement, tu as rêvé. Un bouquin, ça coüte des ronds, il faut le faire lire, le faire corriger, le mettre en maquette et puis l’imprimer. C’est fini le temps où on imprimait tout et n’importe quoi. Les livres sont des denrées rares et si tu n’es pas dans le top 10 des meilleures ventes, on y regardera à trente fois avant d’emmener ta maquette sous presse. D’autant plus si c’est un premier roman.
Je devais avoir la mine renfrognée du gamin à qui on a dit que le Père Noël devait cuver son vin en Laponie, car Jonas s’assit à côté de moi avec un air presque compatissant, j’ai même eu peur qu’il s’approche de trop près pour me faire un câlin.
– Ecoute-moi… (j’avais eu raison de ne pas vouloir qu’il m’approche de trop près, son haleine sentait le phoque faisandé) Fais-moi confiance, je connais quelques personnes qui sont tout à fait aptes à reconnaître les talents quand ils se présentent.
– Bon passons, je me casse… J’ai trop mal au crâne, je repasserai un de ces jours, c’est pas possible là. Je me tournai vers lui. Tu sais Jonas, j’apprécie ce que tu fais, je te revaudrai ça.
– C’est ça, dit-il avec une moue qui en disait long sur ses doutes. Fais-toi déjà éditer, on verra ça plus tard.
J’ai pris la tangente, trop imbibé encore pour réfléchir calmement. Je ne me sentais pas bien, chancelant et l’odeur de son haleine chargée d’alcool mal digéré m’avait porté sur le coeur. Tout en moi était révolutionné, comme si la disposition de chacun de mes viscères avait soudain changé sous l’effet des abus divers et variés. C’est peut-être ça qu’on appelle le désordre intérieur….
Je pris le métro pour retourner sur l’île Saint-Louis, dans mon luxueux appartement. En chemin, j’eus une terrible sensation, quelque chose qui me disait de profiter de ce que j’avais parce que ça ne durerait pas, mais je n’arrivais à savoir si c’était dans le sens où j’allais tout perdre ou au contraire tout gagner. Un mal-être m’envahit et je posais la tête sur la vitre sale et pleine de miasmes en fermant les yeux.
J’étais assis à côté d’une indienne qui empestait un parfum bon marché et qui écoutait à fond de la musique tout droit sortie d’un film de Bollywood, et face à une grosse bonne femme d’une cinquantaine d’années qui lisait un brülot politique de Barbara Cartland. Je fus soudain pris d’un haut-le-coeur, ne sachant si c’était à cause du parfum ou du livre, mais je maudissais tous ces éditeurs qui vendaient de la merde à prix d’or, comme si tout ce que le peuple était capable d’ingurgiter n’était bon qu’à nourrir les rats. Aucun amour propre. Ce qui se vend se vend parce que ça s’achète… j’avais envie de me lever et de crier au monde entier qu’il fallait arrêter de lire ces torchons !! Demandez la lune ! Les éditeurs vous la vendront ! Et puis je songeais à moi, Romuald, avec mes bouts de papier qui allaient bientôt se retrouver entre les mains des comités de lecture, le célèbre Romuald qui n’avait encore édité que des morceaux disséminés ça et là dans la nature… Je songeais à tout ce qui m’arriverait lorsque je serais célèbre et à tout ce que je pourrais m’offrir. Il n’y avait pas si longtemps que ça, Yan avait osé me demander pourquoi j’écrivais. Je l’ai regardé avec étonnement, et je lui ai dit de plutôt me demander pourquoi je voulais me faire publier, alors il a reformulé sa question. Je lui ai dit, mais comme tout le monde, j’écris pour devenir célèbre, et je veux devenir célèbre, parce que quand tu es célèbre, tu bouffes dans des restos aux moquettes épaisses et aux couleurs chatoyantes, et tu peux picoler à l’oeil, et puis tu sors avec toutes les filles que tu veux, parce que les filles adorent les écrivains célèbres et qu’elles adorent sentirent contre leur corps plantureux ton corps malingre et sec d’écrivain célèbre et riche qui mange dans des restos luxueux et branchés. Voilà.
Je me réveillai comme par enchantement à Hôtel-de-Ville, groggy, la tête à l’envers et j’eus juste le temps de sauter hors de la rame alors que les portes se fermaient, avec une douceur propre aux engins automatisés.
Je repris mon souffle une fois sur le quai… Mon coeur battaient la chamade, comme à chaque fois que je me réveille en sursaut. J’avisai un siège crasseux et je m’y assis. Un odeur âcre de pisse croupie envahissait l’air, mais je pris tout de même de grosses bouffées d’air, en respirant profondément pour chasser ces coups de boutoir qui sévissaient dans mes tempes, dans ma poitrine et dans quelques autres endroits inconnus et sans nom, bien nichés au creux de mon corps. Je me relevai et ouvris les yeux. Face à moi, une immense affiche sur laquelle s’étalait la belle gueule d’amour de Tom Cruise me narguait de toute sa hauteur, si je puis dire. Je me dis que ça faisait au moins cinq ans que je n’avais pas mis les pieds dans une salle de cinéma, et la dernière séance avait dü être Kagemusha, l’ombre du guerrier de Kurosawa. Je m’étais endormi dès les cinq premières minutes qui sont, il faut bien l’avouer, particulièrement longues, très belles, mais très longues. J’avais sombré d’un seul coup et je m’étais réveillé pour voir le nom des acteurs en japonais sur le générique de fin. Une chance ! Au loin, il me semblait entendre le crissement particulièrement aigü d’un train à l’approche, un son strident qui me fit mal à la tête et résonna dans mes mâchoires. Je tournai la tête vers la gauche comme pour tenter de chasser ces mauvaises ondes qui s’insinuaient en moi, et mon regard tomba sur un homme assis à une dizaine de mètres de moi. C’était bien la dernière personne que je m’attendais à voir ici. Je reconnus immédiatement le Japonais du Pont des Arts, qui me regardait avec un très léger sourire, presque imperceptible, dans lequel je pouvais comme déceler une ombre de malice. Il me fixa quelques secondes et ne bougea que la tête pour fixer droit devant lui un point, un horizon que lui seul voyait. Je rencontrais rarement la même personne deux fois, surtout à Paris, ce qui eut le don de me troubler, mais je repris bien vite mes esprits lorsque j’entendis le métro arriver sur le quai d’en face. Il déversa son flot d’odeurs, de pas, de bruit et de fureur sur le quai et repartit avec autant d’empressement qu’il était arrivé, ne laissant place qu’à un silence grandissant. Je restai là, assis, les mains sur les genoux. Le Japonais m’imitait. Il me regardait encore.
Une ombre, ou plutôt une couleur attira mon attention. Un vêtement de couleur vive, un rouge éclatant dessiné sur des lèvres fines, deux grandes jambes gaînées de blanc qui fendaient l’air, en rythme avec le claquement de talons fins. Une femme au corps ondulant remontait le quai de part en part pour se diriger vers la sortie. C’était elle. Je me levai d’un seul coup, comme saisi par une outrecuidance divine, la mâchoire inférieure comme décrochée, je n’en revenais pas de la retrouver ici. J’aurais voulu lui courir après, sauter par dessus les rails mais je ne pouvais plus bouger et la seule chose absurde que je trouvai à faire, c’était de regarder le Japonais, comme pour lui demander à quoi tout ça rimait. Mais il était parti, volatilisé. Parti sur la pointe des pieds, très certainement. Et puis le temps que j’essaie de trouver un sens à tout ça, Lily aussi avait disparu. Une fois de plus, je me retrouvai seul comme un couillon sur le quai. Sans savoir quoi faire.
Mais je sus bien vite finalement, que le plus sage était de rentrer chez moi. Enfin, chez les autres.
11. Finalement, j’ai laissé Jonas s’occuper de tout. Je lui ai apporté trois cartons d’exemplaires photocopiés à grands frais dans un de ces supermarchés de la reproduction – hum, ceci n’a absolument rien de sexuel – et je l’ai laissé se débrouiller avec tout ce fatras. Très sincèrement, je ne voulais pas jouer les démarcheurs auprès des maisons d’édition et j’avais pris le parti de mettre à disposition ce temps gagné pour continuer à écrire un peu. Je m’étais acheté trois carnets à élastiques, sur lesquels je notais tout ce qui pouvait me servir à écrire par la suite: descriptions, analyses, exercices de style, notes en tout genre, ébauches d’idées, une sorte de carnet d’esquisse pour écrivain. J’avais à disposition de la matière pour ne pas tomber dans l’oisiveté, et puis j’avais fini par me rendre compte que si je voulais devenir un vrai écrivain… Il fallait que je m’habitue à ne faire que ça. En même temps, il existait tout de même des professions plus désagréables. Et dire que j’ai exercé des métiers qui ne portent même pas de nom, la plupart du temps pour payer mes factures et avoir à peine de quoi manger ! J’en avais encore de l’urticaire rien que d’y penser. Tout ceci appartenait désormais au passé, et comme je l’avais dit à Yan, ce que je désirais vivre à partir de là, n’était que le faste et la jouissance que pouvait apporter une vie oisive en dehors de toute écriture, faite de mots couchés sur le papier, d’argent facile, de luxe, de reconnaissance, de bons restaurants entouré de jeunes filles avides de sexe, couchées lascivement sur de grands lits blanc aux draps de satin… Conneries que tout ça ! Si c’était ce que je voulais, il ne fallait pas que je devienne écrivain, je me trompais certainement…
Je partis dans mes méditations tandis que j’étais nu dans ma baignoire – dans la baignoire de mes bienheureux propriétaires -, tandis que je subissais depuis plusieurs heures déjà les premiers symptômes d’un rhume qui allait me pourrir la vie. La proximité orthographique du mot rhume
avec rhum
m’a toujours laissé croire que l’un pouvait être guéri par l’autre, mais dans la pratique, on sait que ce n’est pas aussi facile, d’autant plus qu’il n’y a aucun rapport étymologique entre rhume et migraine, surtout si on passe par la case rhum. Bref. J’avais déjà l’impression de vivre dans une bulle, la gorge me démangeait, le nez commençait à couler, et pire que tout, ce que je déteste, c’est que les oreilles se bouchent pour une durée indéterminée… Non seulement on a l’impression de vivre dans du coton, mais chez moi cela signifie subir des acouphènes qui confinent à la folie, me donnant parfois l’impression de vivre des hallucinations auditives. J’entends des bruits qui ne peuvent exister dans le monde réel, et ça, c’est réellement insupportable. Je n’ai rien d’un névrosé, même si pas mal des gens que je connais sont persuadés du contraire.
Les orifices bouchés, je m’enfonçais dans l’eau brulante, persuadé que de cette manière, l’eau n’arriverait pas à entrer dans mon corps. C’est parfois difficile à avouer, mais je déprimais, je me sentais vraiment mal, comme étreint par une angoisse dont je n’arrivais pas à comprendre l’origine. Il y a généralement, pourtant, mille et une raison dans une vie de sentir angoissé, mais a priori, dans la mienne, rien ne laissait présager que ça puisse arriver, alors même que je commençais à me relever, à sortir de l’anonymat suave qui me permettait de vivre caché, invisible aux yeux d’une société que se permettait de reluquer dans les coins.
Comment un corps qui passe de l’anonymat à la célébrité se métamorphose t-il ? Eprouve t-il des changements perceptibles ou alors reste t-il le même, intègre et passionné, toujours aussi empreint de ses malaises et de ses vicissitudes ? Comme si ça pouvait faire une différence. Le corps glorieux ? Hmmm, ça sonne trop catholique comme notion… En fait, la gloire n’est pas une notion qui m’intéressait en soi, car d’une manière ou d’une autre, ce que je souhaitais par-dessus tout, c’était devenir célèbre, pour quelques raison que ce soit. La gloire, c’était bon pour les Proust et les Balzac, que l’on vénère par-dessus les frontières temporelles et qui n’arrive bien souvent qu’une fois que l’on mange les pissenlits par la racine, tandis que la célébrité, c’est comme les bonbons à la menthe, ça fond dans la bouche et on ne garde la fraîcheur sur la langue que quelques heures, mais au moins, on a tout le loisir d’en ressentir l’intensité tant que c’est là. Je voulais qu’on me reconnaisse dans la rue, qu’on n’ose pas m’approcher mais qu’on me désigne du doigt et entendre des bouts de phrases indiscrets… Oh regarde, c’est machin, il est mieux en vrai que sur la pochette de son bouquin ou alors La vache, c’est à croire qu’il picole ce mec, ou alors il ne dort pas assez…. Voilà, tout ça c’était pour moi, et une fois encore, je me demandais si c’était bien en devenant écrivain qu’on pouvait accéder à ça… Et puis finalement, je me suis aperçu bien vite que tout ça me foutait les jetons. Alors j’ai arrêté de penser.
Et puis j’ai passé de longues minutes à regarder mon corps. On n’a pas souvent l’occasion de se regarder, sans s’admirer forcément, mais simplement examiner chaque partie de son corps, dans l’espoir d’y trouver quelque chose qu’on n’y avait encore jamais vu. Un vieux grain de beauté qui avait fait son apparition en 1982 et dont on ne s’était plus préoccupé, peut-être a t-il grossi, s’est-il transformé en truc cancéreux, ou alors cet ongle incarné qu’on avait l’habitude de guérir tous les étés, en tentant de couper au mieux, ou au plus ras… Je ne pensais pas découvrir de malformations spontanées ou miraculeuses, ni même de quoi se décréter tout à coup comme celui qui avait les plus belles fesses, mais simplement, je voulais voir, ou plutôt regarder mon corps, dans une optique coupable. Celle de séduire.
Bon, il se trouve qu’alors que je songeais à toutes ces petites conjectures à la con qui ne faisaient pas vraiment avancer les choses, je n’avais pas un rond en poche, juste de quoi croquer de manière frugale tous les jours, mais guère plus. Evidemment, je pouvais compter sur mes amis, mais autant que possible, j’essayais de faire en sorte de ne pas trop leur faire les poches… Uniquement lorsque j’étais à deux doigts de sombrer. Parmi mon groupe d’amis, j’étais le seul à ne rien posséder, et généralement ils le prenaient bien et jamais ils ne se permettaient de me juger ou quoi que ce soit. C’était mon style de vie et personne n’y trouvait rien à redire. Ils le savaient, mais ils savaient aussi que parfois ma solitude contrainte et volontaire me causait également du tort. Alors que, dans les innombrables soirées dans lesquelles j’allais, déguisé en pique-assiette, j’avais toujours mille occasions de me faire plaisir avec la première délurée qui bougeait son cul, comme le faisaient les autres sans vergogne, je me complaisais dans ma chasteté monstrueuse qui me faisait passer soit pour un coincé, soit pour un asexuel.
L’air du dehors était saturé de petites molécules moites et malodorantes. Il faisait très chaud. J’avais passé une partie de ma journée au café à écrire. Ma chemise était trempée et sentait la transpiration. Je n’avais hérité de mon père que de rares défauts, mais il avait réussi à me refiler l’odeur de sa peau, et ça, pour moi, c’était le comble. Certaines m’avait confié que l’odeur de ma transpiration avait quelque chose de sauvage, mais pour ma part, je ne trouvais ça en rien excitant. D’ordinaire, je ne prenais que des douches, dans un souci d’économie de temps. J’ai jeté mes fringues poisseuses dans la machine et j’ai lancé un programme court. Dans un coin, sur le rebord de la baignoire, il y avait un miroir portatif. je l’ai posé derrière les robinets et je me suis allongé pour me mouiller complètement. J’écoutais l’eau couler avec fracas dans la baignoire et je pris le miroir pour me scruter. Je n’avais pas de défaut, pas de difformité, pas de tare invisible lorsque j’étais habillé. Ce n’était qu’un corps, un corps mince, uniquement musclé par quelques années de danse, d’une musculature fine et nerveuse. Oui, je me trouvais trop mince, mais bon, j’ai toujours mangé normalement. Rien à faire. Pas moyen de s’empâter un peu. Je regardais mes bras, les poils de mes avant-bras, mes mains avec ces doigts que trouvais trop courts. Plusieurs fois, on m’avait dit que j’avais des mains d’écrivain. Mais c’est quoi des mains d’écrivain ? Ça ressemble à quoi ? Tout ça c’était encore des conneries entendues dans des soirées d’adolescents. Ben quoi ? Ça sent l’encre et la plume ? Les doigts de la main droite plus musclés que ceux de la main gauche ? Conneries, conneries, triples conneries… Je regardais mes pieds. Il parait que j’ai de beaux pieds, mais je n’ai jamais aimé les pieds, pas mêmes les miens. En même temps, je ne suis pas Cendrillon. Pour que ça m’apporte. Je n’avais que trois poils sur la poitrine et rien d’autre. Je regardais mon sexe. Poilu. Enfin pas le pénis, mais le reste. Trop de poils. Ça finissait par me dégouter. Je regardais aussi mon pénis pendouiller dans l’eau chaude comme une grosse nouille trop cuite. Dégoutant. Je le regardais longtemps en ne pensant à rien, parce que ça ne m’inspirait rien du tout. Au bout du compte, il ne me dégoutait pas et je me rendis compte que je le regardais comme si je me demandais à quoi ça pouvait servir. Je me suis senti vide, complètement vidé de tout et je me suis allongé à nouveau en regardant le plafond. Par la fenêtre ouverte, je pouvais sentir l’air entrer et rafraichir la pièce. J’ai du m’endormir quelques instants, juste quelques minutes pour me reposer avant d’aller conquérir le monde.
Le style et la métaphore
Alors que j’étais assis tranquillement sur un pierre au bord de la route, j’ai été interpelé par Fabienne qui, revenant d’un voyage un train avait posé ses yeux sur les lignes d’un livre de Fante, Demande à la poussière, trouvait que certaines phrases auraient pu être écrite par moi. Je n’ai pas la prétention de savoir écrire comme lui, loin de là, mais tout ceci nous a amené à nous poser la question de savoir si l’on lisait les auteurs dont le style nous semblait proche du nôtre ou si au contraire, on écrivait dans un style proche des auteurs que l’on aime. J’ai commencé par répondre Aucun des deux mon général
, et j’en suis finalement venu à la conclusion que c’était plutôt les deux mon général
. Explication de texte.
Selon moi, ce qui structure un être humain dans ses relations sociales, ce sont des niveaux de compréhension, des socles que l’on pourrait appeler des plateaux, des strates imbriquées les unes dans les autres, représentant métaphoriquement des constructions historiques, sociales, religieuses, anthropomorphiques, animistes, politiques, sexuelles, etc. Toutes ces représentations sont nées d’agencement liés à l’histoire de chacun et de ces constructions naissent le désir, ce vers quoi nous sommes naturellement portés. Le style d’un auteur nait également de ces représentation, sous forme de métaphore. Pour parler simplement, le style, c’est la métaphore à l’état pur. Sans style, tout le monde raconterait la même histoire de la même façon, mais là où la métaphore intervient, c’est lorsque deux histoires identiques racontées avec deux styles différents donnent lieu à deux contextes, deux univers, deux façons de représenter et ainsi de suite. pour en revenir à la question primordiale, je pense qu’il existe un socle à partir duquel on se construit et gravitent un certain nombre de choses similaires à ce que j’appelle le désir dans un sens global, et nécessairement, notre écriture et notre direction de lecture participent de ce grand ensemble.Comme je le disais également, ceci n’est que ma vision des choses, laquelle s’inspire d’orientations philosophiques précises. Posez la même question à un adepte de la psychanalyse, il vous répondra que votre Oedipe a un mauvais karma, qu’il se surreprésente dans le ça et qu’il vous faudrait vous allonger là et cracher quelques billets avant de poursuivre.
Sur ce, (message personnel) à présent que j’ai blogué, je m’en retourne dans ma tanière. Prochain billet prévu à la saison des pluies.
Berserkr
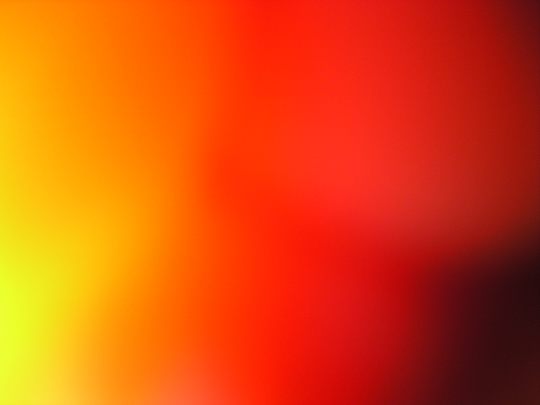
En vieux norrois, Berserkr, c’est la peau d’ours. Dans l’histoire nordique, les Berserkr sont de soldats surentrainés à en être fous, prédisposés à la violence et drogués à saturation, dont la folie leur permettait de se battre sans peur et sans douleur, dans des combats au corps à corps et leur rôle était généralement de partir en première ligne pour effayer l’adversaire. Ça, c’est seulement pour l’anecdote. Mais c’est un peu l’état d’esprit dans lequel je me trouve lorsque je pense à ce qui se passe alentour et qui reste le principal moteur de ma démotivation à l’égard de la blogosphère. L’envie de bloguer s’est étrangement dissipée et l’envie de lire d’autres blogs ne m’inspire pour l’instant qu’une sorte de répulsion, comme si d’en avoir bouffé pendant presque 4 ans m’avait donné la nausée à la simple évocation du mot. Et ça n’a pas l’air de s’arranger.
Et tout ceci n’est pas forcément innocent. J’ai lu un billet récent de mon ami Benoit dans lequel il parle du survol.
Parfois, je me dis que la seule façon d’espérer lancer une discussion est de carrément le dire d’entrée de jeu, poser une question. Parce qu’il me semble qu’il y a beaucoup de survols, mais peu d’arrêts prolongés, assez prolongés pour prendre le temps de discuter. On survole beaucoup la blogosphère…
Tout est dit, et après avoir lu ces mots hier soir, j’ai grandement cogité sur ce qu’était réellement l’acte de bloguer et décidément, je me dis que dès lors qu’on a pris le parti de mettre une grande partie de son âme et de son intimité dans une moulinette qui n’a d’autre vocation que d’être publique, on ne peut faire cohabiter certaines choses qui n’ont rien à voir entre elles. L’être est multiple, mais la raison est unique. Un coup d’oeil dans le rétroviseur, et je ne vois derrière moi qu’un écheveau d’idées et un cimetière de blogs aussitôt créés, aussitôt abandonnés. Parce qu’il n’y a pas de cohérence. Comment faire cohabiter un billet sur un peintre douanier comme Louis-Marie Faudacq avec une vaste déconnade sur des clés USB en forme de sushis ? Certaines choses sont faites pour être balancées comme des poissons au fond d’une chalut et d’autre mérite respect et attention, à tel point qu’elle ne devrait pas pouvoir être commentée. Aussi, je ne peux plus bloguer dans ces conditions, au même titre que je ne peux pas non plus continuer à cultiver des embryons de blogs sous cette pépinière de brindilles.
La blogosphère en a pris un sacré coup ces derniers temps, mais je resterai. Je serai toujours là, même lorsque tout ceci ne portera plus de nom. Je suis un blogueur ? Mais avant que les blogs n’existent, j’écrivais déjà, j’ai toujours écrit, et j’écrirai toujours, seule la forme changera. Alors oui, pour l’instant, je ne veux pas me forcer, d’autant plus que j’ai pas mal de boulot, de choses en tête et une nouvelle activité qui me prend beaucoup de temps et d’énergie.
Je ne lis plus beaucoup de blogs, et je lis également moins de livres. Mais je trouve dans le repos une sorte d’équilibre, tandis que naguère je trouvais ma force et mon mordant dans cet état d’excitation intellectuelle constant.
Je me sens plutôt bien, je continue à écrire sans me poser de contrainte et je continue mon petit bonhomme de chemin, et plutôt que le guerrier drogué fonçant sur l’ennemi, je deviens comme cette couleur rouge orangé, d’un calme terrifiant. Et de ce calme suspect naîtra certainement une nouvelle forme d’écriture, exit le blog, exit les noms qui sonnent creux, les choses répétitives et les blocs de granite aussi indesctructible que vides de sens.
All the piers
énormément de choses en retard ou qui restent en suspens comme empêtrées dans un marigot de la Louisiane rien n’avance et moi je mange mon bol de céréales dans le noir d’une nuit qui n’en finit pas alors que le vent souffle remue les arbres les fait plier et la pluie tombe de temps à autre frappant le sol avec une sorte de cliquetis métallique – oui je suis encore malade mais je fais tout pour ne pas me plaindre – engoncé dans un monde de silence qui fuit dans la nuit qui n’en finit pas encore qui traîne des pieds et je monte dans le train qui lui non plus n’en finit pas de s’arrêter je prends une place j’aime bien être assis surtout en ce moment le calme pour lire personne qui parle ce monsieur en face de moi l’air vénérable il lit un bouquin qui a défrayé la chronique avec sa belle barbe poivre et sel parfaitement taillée – sa peau brune et ses beaux yeux sombres l’élégance à l’état pur avec son écharpe en poils de chameaux et sa veste en tweed – et l’autre elle est toute fine de tous petites pieds de jambes toutes fines sous son pantalon elle me tourne le dos – je déteste qu’elles me tournent le dos – une femme sans visage n’existe pas pour moi – et le silence est rompu toujours les deux mêmes pies qui ne cessent de se raconter leur vie monotone et comment tu as fait pour avoir ton prêt et mon mari a voulu une nouvelle voiture elles doivent tout connaitre l’une sur l’autre c’est horrible – ça me fait peur et je descends dans le métro il fait bon il a de l’air qui circule et ça ne pue pas le bruit des freins et des rails est assourdissant mais je suis dans malade dans mon monde et sans rien autour dans la pharmacie aussi il fait bon et je demande un tube de vitamines pour me donner ce coup de fouet dont j’ai besoin – un café un verre d’eau et j’émerge tout doucement – le vent s’est calmé je ne l’entends plus déjà parti certainement vers d’autres horizons frapper d’autres côtes le vent mon élément- sur l’océan – je retourne dans ma prison
Mallard
Plus connue sous le nom de Mallard, la locomotive LNER Class A4 4468 Mallard détient un record particulier, puisque c’est elle qui a battu le record de vitesse absolu pour une locomotive à vapeur. Les Etats-Unis pourtant pionner en matière de chemins de fer et de véhicules de transport ne sont pour rien dans cette histoire puisque la Mallard est une machine 100% Britannique.

Le 3 juillet 1938, ce monstre métallique de 165 tonnes, tender compris a atteint les 126mph soit 203 Km/h entre les villes de Little Bytham et Essendine, pulvérisant ainsi le record allemand de 1936. Destinée au transport de charbon, elle nécessitait une grande puissance, mais sa vitesse de croisière était tout de même de 160 Km/h. A part ces caractéristiques techniques, la Mallard est également reconnue pour son aérodynamisme et son design tout à fait novateur, réalisé par Sir Nigel Gresley. De plus, sa couleur bleue en fait une des plus belles locomotives de l’histoire du chemin de fer. Un monument encore visible au National Railway Museum de York, UK.
Pour mémoire, la locomotive la plus lourde est américaine, c’est une C&O Allegheny (Chesapeake & Ohio Railway) de 1941, pesant plus de 548 tonnes.
Liens:
Bill Bryson – Je ne suis pas d'ici – Introduction – Revenir chez soi
Notes sur mon retour en Amérique, vingt ans après
Introduction
A la fin de l’été 1996, un vieil ami, journaliste à Londres, Simon Kelner, me passa un coup de fil dans le New Hampshire où j’étais installé depuis peu après avoir vécu une vingtaine d’années au Royaume-uni. Simon venait d’être nommé rédacteur en chef du magazine Night & Day, un supplément au journal the Mail on Sunday, et il me proposa d’écrire une chronique hebdomaire sur l’Amérique.
A plusieurs reprises ces dernières années, Simon tenta de me persuader de faire tout un tas de choses que je n’avais pas le temps de faire, mais ça, il en était hors de question.
Non,
dis-je. Je ne peux pas. Je suis désolé. C’est simplement impossible. J’ai trop de choses à faire.
Donc tu peux commencer la semaine prochaine?
Simon, tu n’as pas l’air de comprendre. Je ne peux pas.
Nous pensions appeler ça Notes d’un Grand Pays.
Simon, tu devras appeler ça Grand Espace Blanc dans le Magazine parce que je ne peux pas le faire.
Splendide, splendide,
dit-il, un rien distrait. J’avais l’impression qu’il faisait autre chose en même temps – passer en revue des mannequins essayant des maillots de bain était la seule idée qui me venait à l’esprit. Quoi qu’il en soit, il masquait le combiné, passant ses consignes de rédacteur aux personnes alentour.
Bon alors, nous allons t’envoyer le contrat,
me dit-il lorsqu’il reprit le combiné.
Non, Simon, ne fais pas ça. Je ne peux pas t’écrire une chronique par semaine. C’est aussi simple que ça. Tu piges? Dis-moi que tu piges.
Excellent. Je suis parfaitement ravi. Nous sommes tous ravis. Bon, je dois te laisser.
Simon, s’il te plait, écoute moi. Je ne peux pas écrire cette chronique. C’est simplement impossible. Simon, tu m’écoutes? Simon? Allo? Simon, tu es là? Allo? Et merde!
Et c’est ainsi que je devins pigiste pendant deux ans, de septembre 1996 à septembre 1998. Le truc que j’ai découvert à propos de cette chronique hebdomadaire, c’est qu’elle revenait toutes les semaines. A présent, ça me semble un fait évident, mais en deux ans, il ne s’est pas passé une semaine sans que cela ne me paraisse aussi bien dément qu’effrayant. Une autre chronique? Déjà? Mais, je viens d’en rendre une!
Je mentionne ceci afin de préciser qu’il n’était pas prévu que ce soit – ça ne pouvait pas – être un portrait systématique de l’Amérique. La plupart du temps, j’écrivais des anecdotes qui remplissaient mes journées – un aller et retour à la poste, la joie d’utiliser un broyeur à ordures pour la première fois, les gloires du motel américain. Néanmoins, j’aimerais croire que ces textes traduisent une sorte de progrès, du fait d’être constamment perplexe et souvent révolté, les tous premiers jours de mon arrivée, au fait d’être perplexe et généralement envoûté, impressionné, et satisfait à présent. (La perplexité, vous le noterez, est une constante dans ma vie, où que je sois.) Le fait est que je suis très heureux d’être ici. J’espère que ce qui suit l’exprime clairement.
Ces articles ont été, dans un premier temps, écrits pour un lectorat Britannique et par nécessité, incluaient des explications conséquentes qu’un Américain trouverait superflues, comme par exemple comment fonctionnent les finales d’après-saison au base-ball, qui était Herbert Hoover, ce genre de choses. J’ai tenté d’expurger discrètement ces intrusions, mais parfois, le cours du texte m’interdisait ces ajustements. Je m’en excuse, ainsi que pour toutes les erreurs qui s’y seraient glissées par inadvertance.
En plus de Simon Kelner, je tiens à remercier Bill Shinker, Patrick Janson-Smith, John Sterling, Luke Dempsey, et Jed Mattes, chacun de ceux envers qui je suis diversement et profondément redevable, et par dessus-tout, ma chère et très patiente famille qui m’a si aimablement et sportivement laissé les embarquer dans tout ça.
Et un merci tout particulier au petit Jimmy, qui qu’il puisse être.
Revenir chez soi
Dans un livre, j’ai plaisanté une fois sur le fait qu’il y a trois choses qu’on ne peut pas faire dans la vie. On ne peut pas se battre contre la compagnie du téléphone, faire en sorte qu’un serveur vous voit avant qu’il soit décidé à vous voir, et revenir chez soi. Depuis le printemps 1995, je réévaluais silencieusement, avec courage, le troisième point.
En mai de cette année, après deux décennies passées en Angleterre, je suis revenu aux Etats-Unis avec ma femme et mes quatre enfants. Nous nous sommes installés à Hanover, New Hampshire, sans autre justification que cette ville semblait être un endroit terriblement agréable. Fondée en 1761, c’est une chaleureuse et calme petite bourgade, dont la silhouette révèle de mignons clochers, avec un grand terre-plein central, une rue principale au charme suranné et une riche et prestigieuse Université. Dartmouth College, par sa présence à la fois dominante et bienveillante donne à la ville une silhouette gracieuse, une impression d’activité privilégiée, et déverse un flot de 5 000 étudiants, dont pas un seul ne sait traverser la rue prudemment. Avec tout ça, de quoi attirer – bonnes écoles, une excellente librairie et une bibliothèque du même acabit, un vénérable théâtre (Le Nugget, fondé en 1916), un grand choix de restaurants et un bar convivial, le Murphy’s. Doucement séduits, nous avons acheté une maison près du centre et avons emménagé.
Revenir sur sa terre natale après une longue absence est une chose étonnamment perturbante, un peu comme sortir d’un long coma. On découvre que le temps a apporté des changements face auxquels on se sent bête, ne laissant aucune prise. On dépense inconsidérément pour de tous petits achats. On se casse la tête sur les distributeurs automatiques de billets, les pompes à essence et les cabines téléphoniques et on est abasourdi de découvrir, au moment où on vous rattrape par le coude, que les cartes routières dans les stations essence ne sont plus gratuites.
Dans mon cas, le problème était d’autant plus grand du fait que j’étais parti jeune et que je suis revenu entre deux âges. Toutes ces choses que l’on fait comme un adulte – s’endetter, avoir des enfants, accumuler les plans de retraite, s’occuper de l’état des gouttières -, je ne les avais faites qu’en Angleterre. Les choses comme les chaudières ou les fenêtres à guillotine, était, en Amérique, le domaine réservé de mon père. Me retrouver dans une maison de la Nouvelle Angleterre, avec ses mystérieux tuyaux et ses thermostats, son broyeur à ordure capricieux et sa porte de garage automatique menaçante, était à la fois énervant et réjouissant.
C’est assez déconcertant de se trouver à la fois dans et en dehors de votre élément. Je peux énumérer précisément toutes les choses qui me distinguent d’un Américain – lequel des cinquante états a une assemblée unicamérale, ce qu’est un risque-tout[1] au base-ball, qui a joué le rôle de Captain Kangaroo à la télé. Je connais même deux ou trois mots de l’hymne américain, ce qui est déjà plus que certaines personnes que je connais qui l’ont chanté publiquement.
Mais envoyez-moi au magasin de bricolage et encore maintenant, je suis complètement perdu. Pendant des mois, j’ai eu des conversations avec le commis du True-Value[2] d’à côté qui donnaient à peu près ça:
“Bonjour, j’aurais besoin de cette étrange matière dont on remplit les trous laissés par les clous dans les murs. Chez ma femme, on appelle ça Pollyfilla.”
“Ah, vous voulez dire de l’enduit.”
“Très probablement. Et j’aurais également besoin de ces petites choses en plastique que vous fichez dans le mur pour dresser des étagères. J’appelle ça des chevilles.”
“Nous les appelons ancrages[3].”
“Je devrais me le noter quelque part.”
Je pouvais difficilement me sentir plus étranger, à moins de me trouver là habillé en Lederhosen[4]. Tout ceci était assez traumatisant. Alors que j’ai toujours été très heureux lorsque j’étais au Royaume-Uni, je n’ai jamais cessé de voir les Etats-Unis comme mon chez-moi, au sens premier du terme. C’est de là que je venais, ce que je comprenais vraiment, l’aune à laquelle je pouvais tout mesurer.
Ironiquement, rien ne vous fait sentir plus originaire de votre propre pays que de vivre là d’où presque personne ne vient. Pendant vingt ans, être Américain était ce qui me définissait. C’est ainsi que j’étais identifié, différencié. Une fois, j’ai même réussi à décrocher un job de justesse en affirmant, dans un moment d’audace juvénile, à un responsable éditorial du London Times que j’étais le seul de l’équipe à pouvoir épeler correctement Cincinnati. (Et c’était le cas.)
Heureusement, il y a un bon côté à tout ça. Tout ce qui était bon en Amérique avait soudain quelque chose d’ensorcelant. J’étais aussi ébloui que n’importe quel nouveau venu par la facilité légendaire et les bienfaits de la vie quotidienne, l’étourdissante abondance de tout, l’infinie gentillesse des étrangers, la fabuleuse immensité impossible à remplir d’une cave américaine, la joie de rencontrer des serveuses et des employés ayant l’air d’aimer leur métier, la curieuse impression que la glace n’est pas un article de luxe et le fait que les chambres disposent de plusieurs prises murales.
Pareillement, j’éprouvais la joie constante et inattendue de retrouver toutes ces choses avec lesquelles j’avais grandi, mais que j’avais largement oublié: le baseball à la radio, le très satisfaisant claquement d’une porte moustiquaire en été, les insectes luisants, les orages qui repartent aussi vite qu’ils sont arrivés, les énormes chutes de neige, Thanksgiving et le 4 juillet, l’odeur de la mouffette[5] que l’on sent juste le temps de se demander d’un air interrogateur “Est-ce que c’est une mouffette ?”, la Jell-O[6] avec des trucs dedans, la vue plaisante et comique d’un type en short. Tout ceci compte énormément, mine de rien.
Ainsi, tout compte fait, je m’étais trompé. Vous pouvez revenir chez vous. Prenez juste un peu plus d’argent que prévu pour les cartes routières et souvenez vous qu’il faut demander de l’enduit.
Notes
[1] Le terme d’origine est Squeeze-Play
[2] Chaîne de magasins de quincaillerie
[3] Ici, le terme utilisé par Bryson est rawl plug, alors que le mot américain est anchor, d’où l’utilisation du mot ancrage pour la distinction.
[4] Culotte de peau à bretelles revêtu par les Allemands et les Autrichiens, d’aspect folklorique
[5] Les mouffettes constituent une famille d’animaux mustélidés de taille moyenne, noirs et blancs, appartenant à l’ordre des carnivores. On les trouve sur tout le continent américain : ils sont seulement absents de l’extrême nord du Canada.
[6] Gelée de couleur vive, pleine de gélatine.
Blog on strike
C’est pas plus compliqué que ça, je suis pas là, je suis ailleurs, je m’insurge, je colère, je pas content, je grippé, je économie de mots, je fatigué, je sais plus parler, j’ai rien à dire, je rien d’intéressant à dire, j’ai faim et puis (attends, je mange mon flan) la blogosphère est tellement passionnante en ce moment que ça me donne envie de partir sur une île déserte en ayant pris soin de passer mon PC au pilon (Allitération), de tout renier, mes écrits et tout le bordel, bref, c’est pas du joli, alors je creuse un trou, je me cache, je respire plus, silence.
PS: le lecteur averti aura remarqué que pas une seule négation est correctement construite. Dans un mouvement de révolte soudaine, je nie la négation, merde alors…
Monter
Quel sociopathe pourrait ne pas avoir envie de monter dans un ascenseur avec des inconnus ?… Je préfère me taper deux étages à pieds plutôt que de côtoyer les odeurs et les regards infects de trois types que je croise tous les jours, mais que je n’ai strictement aucune envie de connaitre plus.



