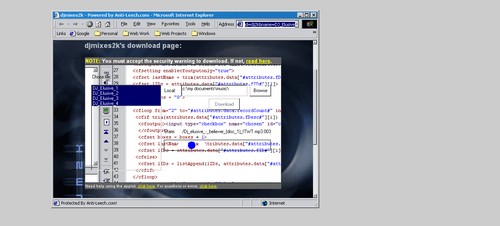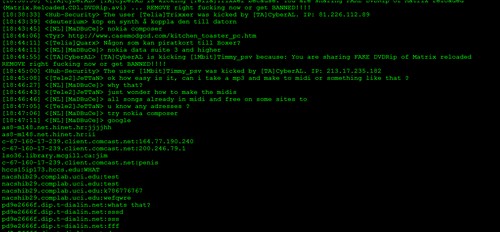Les journées de silence m’envahissent, le tonnerre a grondé hier soir, zébrant la nuit de traces acérées blanchâtres, je m’endors sur le bord de mes rêves. La semaine n’en avait que quatre mais m’a épuisé. Alors ce matin, tandis que je me dis que je devrais me reposer, je prends un peu l’air sur le balcon quand la maison dort encore. Je vais terminer ce livre de Bouvier qu’injustement je délaisse sur ma table de chevet et qui devrait être terminé depuis longtemps, mais comme souvent avec les bonnes choses, on aimerait que ça ne s’arrête pas. Aujourd’hui précisément, j’aurais aimé un peu de calme et de platitude, mais il y a toujours un événement qui en décide autrement ; les choses ne vont jamais comme on le souhaiterait — j’ai des envies de solitude soudaine, l’humanité (il lui faudrait une majuscule) m’emmerde et j’ai envie de le lui rendre. Après tout, pourquoi pas moi.
Je prends la main de Kenya et je l’emmène dans la salle à manger. A deux pas de moi, je regarde ses joues qui ont pris la couleur de l’abricot, de petites taches de son, légèrement parsemées lui font un air à la fois malicieux et candide. Mon appareil photo à la main, je lui dis qu’à compter d’aujourd’hui, je ferai une photo de lui par jour. Il sourit, l’idée le séduit, je le connais, il en sera fier comme un petit banc.
Photo © After Images (From America) par Kai-Olaf Hesse
C’est décidé, aujourd’hui, je me retire. Je vais prendre l’air, je vais marcher, l’air me pèse. Pas pour longtemps.
Dans mes affaires, j’ai quelques carnets noirs, certains encore vierges, planqués sous d’autres affaires entassées dans des cartons. J’ai également, dans un carton qui traine dans le couloir depuis quelques mois, toute cette manne que j’ai rédigé depuis 1995, l’année où j’ai commencé. Je ne sais vraiment pas quoi en faire. Je ne relirai rien de tout ça, je ne les ferai pas lire non plus, mais je ne pense pas que je puisse les jeter non plus. Qu’adviendra-t-il de tout cela si un jour je disparaissais prématurément — ça veut dire quoi prématurément, exactement ? Il n’en adviendra rien, très certainement, ou alors tout finira dans une benne à ordures, même si je meurs vieux.
J’avais besoin de me changer les idées, alors je me suis tourné vers ma voiture qui restait en plan depuis quelques mois — j’ai souri ou plutôt ri jaune lorsque j’ai vu une frêle mousse verte garnir le rebord de mes fenêtres, sur les joints — sur le parking. Évidemment, la batterie était complètement déchargée et les niveaux à zéro. Impossible de la recharger avec les câbles, j’ai dû en racheter une autre. Niveaux de liquide de refroidissement, huile, liquide de direction assistée et même lave-glace — j’ai poussé la perfection jusqu’à racheter des essuie-glace tout neufs. J’ai jeté tout ce qui trainait à l’intérieur, tout ce qui n’y avait pas sa place, passé un coup de chiffon sur les plastiques — si ma voiture avait été une Panhard & Levassor, j’aurais pu dire sur les boiseries — et le tableau de bord. Je l’ai ensuite emmenée au lavage automatique — profites-en cocotte, je n’aime pas comme tous ces blaireaux passer mon temps à te bichonner — pour lui rendre une nouvelle jeunesse. Un dernier coup d’aspirateur et te voici prête à battre la campagne comme aux temps glorieux — avec tes 102 000 kilomètres tu es un peu mon âme guerrière, mon double routier…
Voilà, au moins ça m’aura occupé toute une journée. A présent, je vais mettre un peu d’ordre chez moi — l’ennui me taraude —, je vais ranger ces cartons qui trainent et certainement encore découvrir des trésors que je pensais perdus à jamais et que je prépare une bonne fois pour toutes le rapatriement de mes livres.*
Enfin, pour conclure, mon fils, racontant que sa maîtresse a passé son week-end dans le Périgord, me dit : « Papa, la maîtresse est allée en Cromagnie. »
Un peu surpris, je lui demande de me préciser. Il me répond avec un sourire dont je ne sais si c’est du lard ou du cochon « Ben oui, la Cromagnie, c’est le pays des Hommes de Cro-Magnon !?»